Rendement d’un Moteur Diesel Idéal
Contexte : Le Cycle de DieselUn cycle thermodynamique idéal qui décrit le fonctionnement des moteurs à allumage par compression (moteurs diesel). Il se compose de quatre processus : compression adiabatique, apport de chaleur isobare, détente adiabatique et rejet de chaleur isochore..
Le cycle Diesel est un modèle fondamental en thermodynamique pour l'étude des moteurs à combustion interne à allumage par compression. Contrairement au cycle de Beau de Rochas (Otto) où la combustion est modélisée par un apport de chaleur à volume constant, le cycle Diesel modélise la combustion par un apport de chaleur à pression constante. Cet exercice vise à analyser en détail les transformations subies par le fluide (air, supposé comme un gaz parfait) au cours d'un cycle complet, à calculer les grandeurs thermodynamiques clés (pression, température, travail, chaleur) et à déterminer le rendement thermique du moteur.
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra d'appliquer concrètement les principes de la thermodynamique (premier principe, lois des gaz parfaits, transformations adiabatiques) à un système d'ingénierie essentiel. La compréhension de ce cycle est cruciale pour l'analyse de la performance des moteurs thermiques.
Objectifs Pédagogiques
- Modéliser les quatre transformations d'un cycle Diesel idéal.
- Appliquer la loi des gaz parfaits et les lois de Laplace pour les transformations adiabatiques.
- Calculer les quantités de chaleur et le travail échangés au cours du cycle.
- Déterminer le travail net produit et le rendement thermique du moteur.
- Comprendre l'influence des taux de compression et d'injection sur le rendement.
Données de l'étude
Fiche Technique du Fluide (Air)
| Caractéristique | Symbole | Valeur |
|---|---|---|
| Indice adiabatique (gaz diatomique) | \(\gamma = C_p/C_v\) | 1.4 |
| Capacité thermique massique à volume constant | \(C_v\) | 718 J·kg⁻¹·K⁻¹ |
| Capacité thermique massique à pression constante | \(C_p\) | 1005 J·kg⁻¹·K⁻¹ |
Diagramme P-V du Cycle Diesel Idéal
| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression initiale | \(P_1\) | 1 | bar |
| Température initiale | \(T_1\) | 300 | K |
| Taux de compression volumétrique | \(\alpha = V_1 / V_2\) | 18 | - |
| Taux d'injection | \(\beta = V_3 / V_2\) | 2 | - |
Questions à traiter
- Déterminer les coordonnées thermodynamiques (P, V, T) au point 2, à la fin de la compression adiabatique.
- Déterminer la température \(T_3\) au point 3, à la fin de l'injection isobare.
- Déterminer la température \(T_4\) et la pression \(P_4\) au point 4, à la fin de la détente adiabatique.
- Calculer, par unité de masse, la quantité de chaleur fournie au cycle (\(q_{23}\)) et la quantité de chaleur rejetée (\(q_{41}\)).
- Calculer le travail net fourni par le cycle (\(w_{\text{cycle}}\)) par unité de masse et en déduire le rendement thermique \(\eta\) du moteur.
Les bases de la Thermodynamique Appliquée
Pour résoudre cet exercice, plusieurs concepts et formules de thermodynamique sont nécessaires. Ils permettent de décrire le comportement d'un gaz parfait au cours des différentes transformations du cycle.
1. Lois pour les transformations adiabatiques réversibles (Lois de Laplace)
Pour une transformation sans échange de chaleur avec l'extérieur, les relations suivantes lient la pression, le volume et la température :
\[ P \cdot V^\gamma = \text{constante} \quad | \quad T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante} \quad | \quad T^\gamma \cdot P^{1-\gamma} = \text{constante} \]
2. Premier Principe et Rendement Thermique
Le premier principe de la thermodynamique pour un cycle stipule que le travail net est égal à la chaleur nette échangée : \(W_{\text{cycle}} = Q_{\text{fournie}} + Q_{\text{rejetée}}\). Le rendement thermique \(\eta\) est le rapport du "gain" (travail net) sur la "dépense" (chaleur fournie) :
\[ \eta = \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{fournie}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{rejetée}}|}{Q_{\text{fournie}}} \]
Correction : Rendement d’un Moteur Diesel Idéal
Question 1 : Coordonnées du point 2 (Fin de compression)
Principe
Le passage de l'état 1 à l'état 2 est une compression adiabatique (sans échange de chaleur) et réversible (sans frottement). Le volume du gaz est fortement réduit par la remontée du piston, ce qui provoque une augmentation très importante de sa pression et de sa température.
Mini-Cours
Pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, la variation d'énergie interne \(\Delta U\) est égale au travail des forces de pression \(W\). Comme le gaz est comprimé, \(W > 0\) (le milieu extérieur fournit du travail au système), donc \(\Delta U > 0\), ce qui se traduit par une augmentation de la température \(T\).
Remarque Pédagogique
La clé est d'identifier la nature de la transformation pour choisir le bon outil. "Adiabatique" doit immédiatement vous faire penser aux lois de Laplace. Ne confondez pas avec une transformation isotherme où la température resterait constante.
Normes
Cet exercice se base sur les principes fondamentaux et universels de la thermodynamique classique. Il n'y a pas de "norme" réglementaire au sens du bâtiment, mais on applique les lois physiques qui régissent le comportement des gaz parfaits.
Formule(s)
On utilise les lois de Laplace qui lient les états initial (1) et final (2) d'une transformation adiabatique.
Relation Température-Volume
Relation Pression-Volume
Hypothèses
Le cadre du calcul repose sur plusieurs simplifications du modèle idéal.
- L'air est assimilé à un gaz parfait.
- La compression est réversible (pas de frottements) et adiabatique (très rapide).
- Les capacités thermiques massiques sont constantes.
Donnée(s)
On rassemble les chiffres nécessaires pour cette étape.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température initiale | \(T_1\) | 300 | \(\text{K}\) |
| Pression initiale | \(P_1\) | 1 | \(\text{bar}\) |
| Taux de compression | \(\alpha = V_1/V_2\) | 18 | - |
| Indice adiabatique | \(\gamma\) | 1.4 | - |
Astuces
Pour l'air (gaz diatomique), \(\gamma-1 = 0.4\). Mémoriser cette valeur peut accélérer les calculs. De plus, sachez que le taux de compression \(\alpha\) est toujours supérieur à 1.
Schéma (Avant les calculs)
État 1 : Piston au Point Mort Bas (PMB)
Calcul(s)
Calcul de la température T₂
On part de la formule générale de Laplace. Sachant que le taux de compression est \(\alpha = V_1 / V_2\), on remplace le rapport des volumes par \(\alpha\) :
Calcul de la pression P₂
De même pour la pression, on remplace \(V_1 / V_2\) par \(\alpha\) :
Schéma (Après les calculs)
État 2 : Piston au Point Mort Haut (PMH)
Réflexions
On observe une augmentation spectaculaire de la température (de 300 K à plus de 950 K, soit environ 680°C). C'est précisément cette haute température, obtenue uniquement par compression, qui permet l'auto-inflammation du carburant diesel injecté, éliminant ainsi le besoin de bougies d'allumage.
Points de vigilance
Unités : Toujours utiliser les températures en Kelvin (K) dans les formules de thermodynamique. Ne pas oublier de convertir les pressions en Pascals (Pa) si on doit les utiliser dans d'autres calculs (comme la loi des gaz parfaits), même si on peut laisser les bars ici car c'est un rapport.
Points à retenir
Pour une compression adiabatique, les formules de base à maîtriser sont :
- Température finale : \(T_f = T_i \cdot (\text{rapport de compression})^{\gamma-1}\)
- Pression finale : \(P_f = P_i \cdot (\text{rapport de compression})^{\gamma}\)
Le saviez-vous ?
L'idée originale de Rudolf Diesel était de créer un moteur avec un rendement si élevé (en utilisant une très forte compression) qu'il pourrait rivaliser avec la machine à vapeur. Il l'a conçu pour fonctionner avec diverses huiles végétales, anticipant l'usage des biocarburants de plus d'un siècle !
FAQ
Il est normal d'avoir des questions.
Résultat Final
A vous de jouer
Si le taux de compression \(\alpha\) était de 20, quelle serait la nouvelle température \(T_2\) en Kelvin ? (garder \(T_1=300\) K et \(\gamma=1.4\))
Question 2 : Température au point 3 (Fin d'injection)
Principe
La phase 2→3 modélise la combustion. Le carburant est injecté et s'enflamme spontanément dans l'air chaud. On suppose que l'injection est régulée de sorte que la pression reste constante pendant que le piston commence déjà à descendre. Cet apport de chaleur fait augmenter le volume et la température du gaz.
Mini-Cours
Pour une transformation isobare (pression constante), l'apport de chaleur \(Q_p\) sert à la fois à augmenter l'énergie interne du gaz (\(\Delta U\)) et à fournir un travail de détente (\(W < 0\)). Selon la loi des gaz parfaits \(PV=nRT\), si P est constant, alors \(V/T\) est constant. C'est la loi de Charles.
Remarque Pédagogique
Le mot-clé ici est "isobare". Oubliez les lois de Laplace. La relation entre volume et température est beaucoup plus simple et directe. Si la pression est constante, une augmentation de volume implique nécessairement une augmentation proportionnelle de la température absolue.
Normes
Aucune norme spécifique, on applique la loi de Charles, une des lois fondamentales des gaz parfaits.
Formule(s)
L'outil mathématique est la loi de Charles, qui découle de la loi des gaz parfaits à pression constante.
Hypothèses
On suppose que la combustion est parfaitement isobare, c'est-à-dire que la pression ne varie pas entre le début et la fin de l'injection du carburant.
Donnée(s)
On utilise la température calculée à la question précédente et le taux d'injection \(\beta\).
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température en début d'injection | \(T_2\) | 953.3 | \(\text{K}\) |
| Taux d'injection | \(\beta = V_3/V_2\) | 2 | - |
Astuces
La relation est une simple proportionnalité. Si le volume double ( \(\beta=2\)), la température absolue double aussi. C'est un calcul très direct.
Schéma (Avant les calculs)
État 2 : Début d'injection
Calcul(s)
Calcul de la température T₃
On applique la loi de Charles. Sachant que le taux d'injection est \(\beta = V_3 / V_2\), on remplace le rapport des volumes par \(\beta\) :
Schéma (Après les calculs)
État 3 : Fin d'injection
Réflexions
La température atteint ici son point culminant dans le cycle, dépassant 1900 K (plus de 1600°C). C'est cette très haute température qui confère au gaz une grande énergie, qui sera ensuite convertie en travail utile lors de la phase de détente.
Points de vigilance
N'utilisez surtout pas les lois de Laplace pour cette étape ! La transformation est isobare, et non adiabatique. C'est une erreur classique de vouloir appliquer les mêmes formules à toutes les étapes du cycle.
Points à retenir
La formule clé pour la combustion isobare est une simple proportionnalité : \(T_{\text{fin}} = T_{\text{début}} \cdot \beta\), où \(\beta\) est le rapport des volumes \(V_{\text{fin}}/V_{\text{début}}\).
Le saviez-vous ?
Dans un moteur réel, la pression n'est pas parfaitement constante durant la combustion. Elle a tendance à augmenter légèrement au début avant de diminuer. Le diagramme P-V réel est donc plus "arrondi" que le rectangle parfait du modèle idéal.
FAQ
Questions fréquentes sur cette étape.
Résultat Final
A vous de jouer
Si le taux d'injection \(\beta\) était de 2.5, quelle serait la nouvelle température \(T_3\) en Kelvin ? (garder \(T_2=953.3\) K)
Question 3 : Coordonnées du point 4 (Fin de détente)
Principe
La transformation 3→4 est la phase de travail principale du moteur. Les gaz chauds et à haute pression se détendent en poussant le piston vers le bas. Cette détente est supposée adiabatique (très rapide) et réversible, ce qui entraîne une chute de la température et de la pression.
Mini-Cours
C'est une détente adiabatique. Le système (le gaz) fournit du travail au milieu extérieur (il pousse le piston), donc \(W < 0\). D'après le premier principe \(\Delta U = W\), l'énergie interne du gaz diminue, et donc sa température chute. C'est la conversion de l'énergie thermique en travail mécanique.
Remarque Pédagogique
De retour à une transformation adiabatique ! On ressort donc les lois de Laplace. La seule difficulté est de correctement définir le rapport de volume pour cette détente, qui n'est pas \(\alpha\).
Normes
Les lois de la thermodynamique sont de nouveau la seule référence ici.
Formule(s)
On utilise les lois de Laplace entre les points 3 et 4, après avoir exprimé le rapport de détente \(V_4/V_3\). Sachant que \(V_4 = V_1\), on a :
Rapport de détente
Relations de Laplace
Hypothèses
La détente est supposée parfaitement adiabatique (pas de pertes de chaleur vers les parois) et réversible (sans frottements).
Donnée(s)
On repart des résultats des questions précédentes.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température initiale détente | \(T_3\) | 1906.6 | \(\text{K}\) |
| Pression initiale détente | \(P_3 = P_2\) | 57.2 | \(\text{bar}\) |
| Taux de compression | \(\alpha\) | 18 | - |
| Taux d'injection | \(\beta\) | 2 | - |
Astuces
Ne calculez pas les volumes eux-mêmes ! La thermodynamique des cycles moteurs se résout presque entièrement avec des rapports de volumes (\(\alpha\), \(\beta\)). C'est beaucoup plus simple et élégant.
Schéma (Avant les calculs)
État 3 : Début de détente
Calcul(s)
On applique les formules avec le rapport de détente inverse \(V_3/V_4 = \beta/\alpha\).
Rapport de détente
Calcul de la température T₄
Calcul de la pression P₄
Schéma (Après les calculs)
État 4 : Fin de détente (PMB)
Réflexions
La température et la pression ont considérablement chuté, mais la pression finale \(P_4\) est encore supérieure à la pression initiale \(P_1\). Cela signifie qu'il reste de l'énergie dans les gaz d'échappement qui ne sera pas convertie en travail, ce qui est une source d'irréversibilité dans le cycle réel.
Points de vigilance
L'erreur la plus commune est d'utiliser le mauvais rapport de volume. Le rapport de compression \(\alpha\) s'applique à la transformation 1→2. Pour la détente 3→4, le rapport est \(\alpha/\beta\).
Points à retenir
La détente adiabatique est le miroir de la compression, mais avec un rapport de volume différent. La maîtrise du calcul des rapports de volume est essentielle pour analyser les cycles.
Le saviez-vous ?
Pour améliorer le rendement, certains moteurs utilisent des turbocompresseurs. Une turbine est placée à l'échappement pour récupérer une partie de l'énergie résiduelle des gaz (à la pression \(P_4\)) et l'utiliser pour pré-comprimer l'air d'admission, améliorant ainsi le remplissage du cylindre.
FAQ
Questions fréquentes.
Résultat Final
A vous de jouer
Si \(\alpha=20\) et \(\beta=2.5\), le rapport de détente \(\alpha/\beta\) serait de 8. En partant de \(T_3=2383\) K, quelle serait la température \(T_4\) ?
Question 4 : Transferts de chaleur par unité de masse
Principe
Dans un cycle moteur, l'énergie est apportée sous forme de chaleur par la combustion (\(q_{\text{fournie}}\)) et une partie est inévitablement perdue sous forme de chaleur dans les gaz d'échappement (\(q_{\text{rejetée}}\)). On calcule ces deux quantités.
Mini-Cours
La quantité de chaleur échangée par un système dépend de la transformation. Pour une transformation isobare (pression constante), on utilise la capacité thermique à pression constante : \(q_p = C_p \Delta T\). Pour une transformation isochore (volume constant), on utilise la capacité thermique à volume constant : \(q_v = C_v \Delta T\).
Remarque Pédagogique
Faites très attention au type de transformation pour choisir la bonne capacité thermique (\(C_p\) ou \(C_v\)). Pensez aussi au signe : si la température augmente, la chaleur est reçue (positive). Si elle diminue, la chaleur est cédée (négative).
Normes
On applique les définitions standards des transferts de chaleur en thermodynamique.
Formule(s)
Les formules découlent directement des définitions de \(C_p\) et \(C_v\).
Chaleur fournie (isobare)
Chaleur rejetée (isochore)
Hypothèses
On suppose que \(C_p\) et \(C_v\) sont constants sur les plages de température considérées, une simplification du modèle de gaz parfait.
Donnée(s)
On utilise les températures calculées précédemment et les capacités thermiques de l'air.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Capacité thermique isobare | \(C_p\) | 1005 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |
| Capacité thermique isochore | \(C_v\) | 718 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |
| Température au point 1 | \(T_1\) | 300 | \(\text{K}\) |
| Température au point 2 | \(T_2\) | 953.3 | \(\text{K}\) |
| Température au point 3 | \(T_3\) | 1906.6 | \(\text{K}\) |
| Température au point 4 | \(T_4\) | 789.7 | \(\text{K}\) |
Astuces
Pour vérifier vos calculs, rappelez-vous que \(\gamma = C_p / C_v\). Pour l'air, 1005 / 718 \(\approx\) 1.4. Cela peut vous aider à retrouver une valeur si vous en avez oublié une.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma : Flux de chaleur sur le cycle
Calcul(s)
On procède à l'application numérique pour les deux transferts de chaleur.
Calcul de la chaleur fournie
Calcul de la chaleur rejetée
Schéma (Après les calculs)
Comparaison des Flux de Chaleur
Réflexions
Le signe négatif pour \(q_{41}\) confirme qu'il s'agit bien d'une chaleur perdue par le système. On constate qu'une part non négligeable de l'énergie apportée (environ 351.6 / 958.2 \(\approx\) 37%) est perdue dans les gaz d'échappement. C'est cette perte qui limite le rendement du moteur.
Points de vigilance
L'erreur la plus fréquente est d'inverser \(C_p\) et \(C_v\). Retenez : Pression constante -> Cp. Volume constant -> Cv. De plus, faites attention aux unités : les capacités sont en J/kg/K, il est pratique de convertir le résultat final en kJ/kg.
Points à retenir
Les deux formules de transfert de chaleur à retenir sont : \(q_p = C_p (T_{\text{fin}} - T_{\text{deb}})\) et \(q_v = C_v (T_{\text{fin}} - T_{\text{deb}})\). Leur application correcte est fondamentale.
Le saviez-vous ?
Dans un moteur réel, la chaleur "rejetée" n'est pas enlevée instantanément. C'est le processus d'échappement (où les gaz chauds sont expulsés) et d'admission (où l'air frais entre) qui assure le retour à l'état initial. Le modèle isochore est une simplification de ce processus complexe.
FAQ
Questions fréquentes.
Résultat Final
A vous de jouer
Si, dans un autre cycle, la température en fin de détente \(T_4\) était de 850 K (avec \(T_1=300\) K), quelle serait la chaleur rejetée \(q_{41}\) en kJ/kg ?
Question 5 : Travail net et Rendement thermique
Principe
Le but ultime d'un moteur est de produire du travail mécanique. Le travail net est ce que le cycle produit réellement, après avoir "payé" le coût énergétique de la compression. Le rendement mesure l'efficacité de cette conversion d'énergie thermique (carburant) en énergie mécanique (travail).
Mini-Cours
Le Premier Principe de la Thermodynamique pour un cycle énonce que la variation totale d'énergie interne est nulle (\(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\)). Par conséquent, le travail total échangé est égal à la chaleur totale échangée : \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\). En convention moteur (travail fourni compté positivement), \(w_{\text{cycle}} = q_{\text{fournie}} + q_{\text{rejetée}}\).
Remarque Pédagogique
Le rendement est le concept le plus important pour juger de la performance d'un moteur. C'est le rapport de "ce que vous gagnez" (le travail) sur "ce que vous dépensez" (la chaleur du carburant). Un rendement de 60% signifie que 60% de l'énergie du carburant est transformée en mouvement, les 40% restants étant perdus en chaleur.
Normes
La définition du rendement thermique est une convention universelle en ingénierie et en physique.
Formule(s)
On utilise le bilan énergétique du cycle et la définition du rendement.
Travail net du cycle
Rendement thermique
Hypothèses
Les calculs se basent sur les hypothèses du cycle idéal (pas de frottements, transformations parfaites), ce qui donne un rendement théorique maximal.
Donnée(s)
On utilise les chaleurs spécifiques calculées à la question précédente.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Chaleur fournie | \(q_{\text{fournie}}\) | 958.2 | \(\text{kJ/kg}\) |
| Chaleur rejetée | \(q_{\text{rejetée}}\) | -351.6 | \(\text{kJ/kg}\) |
Astuces
Une fois le rendement \(\eta\) calculé, vous pouvez trouver le travail net plus rapidement avec \(w_{\text{cycle}} = \eta \cdot q_{\text{fournie}}\). C'est une bonne façon de vérifier vos calculs.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma : Le travail net sur le diagramme P-V
Calcul(s)
On finalise l'exercice avec les derniers calculs.
Calcul du travail net du cycle
Calcul du rendement thermique
Schéma (Après les calculs)
Schéma : Bilan Énergétique (Diagramme de Sankey)
Réflexions
Un rendement théorique de 63.3% est excellent et met en évidence l'un des grands avantages du moteur Diesel : son efficacité, due principalement à son taux de compression élevé. En réalité, les pertes par frottement, les transferts thermiques et les combustions imparfaites ramènent le rendement des meilleurs moteurs Diesel automobiles autour de 40-45%.
Points de vigilance
Attention aux signes dans le calcul du travail ! \(w_{\text{cycle}} = q_{\text{fournie}} + q_{\text{rejetée}}\) en utilisant la valeur algébrique de \(q_{\text{rejetée}}\) (qui est négative). Si vous utilisez la valeur absolue, la formule devient \(w_{\text{cycle}} = q_{\text{fournie}} - |q_{\text{rejetée}}|\).
Points à retenir
La performance d'un cycle moteur se résume à deux grandeurs : le travail net \(w_{\text{cycle}}\) (combien d'énergie mécanique il produit) et le rendement \(\eta\) (avec quelle efficacité il le fait). La formule \(\eta = 1 - |q_{\text{rejetée}}|/q_{\text{fournie}}\) est universelle pour tous les cycles thermiques.
Le saviez-vous ?
Les plus grands moteurs Diesel du monde sont des moteurs 2-temps lents utilisés pour la propulsion des super-pétroliers. Certains de ces géants, hauts comme un immeuble de 4 étages, dépassent un rendement réel de 50%, une prouesse d'ingénierie.
FAQ
Questions finales.
Résultat Final
A vous de jouer
Si un moteur a un rendement de 45% et reçoit 1000 kJ/kg de chaleur, quel travail net produit-il en kJ/kg ?
Outil Interactif : Simulateur de Rendement Diesel
Utilisez les curseurs pour faire varier le taux de compression \(\alpha\) et le taux d'injection \(\beta\). Observez comment le rendement thermique théorique du cycle Diesel évolue. Le graphique montre l'influence de \(\alpha\) pour une valeur de \(\beta\) fixée.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Quelle est la principale différence entre le cycle Diesel idéal et le cycle Otto idéal ?
2. Comment le rendement d'un cycle Diesel idéal évolue-t-il si on augmente le taux de compression \(\alpha\) (en gardant \(\beta\) constant) ?
3. Que se passe-t-il pendant la transformation 4 → 1 ?
4. Le taux d'injection \(\beta\) est défini par le rapport :
5. Pour une même taux de compression, le rendement du cycle Otto est-il supérieur ou inférieur à celui du cycle Diesel ?
Glossaire
- Cycle de Diesel
- Modèle thermodynamique décrivant le fonctionnement d'un moteur à allumage par compression. Il est caractérisé par un apport de chaleur à pression constante.
- Processus adiabatique
- Une transformation thermodynamique qui se produit sans aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur (Q=0).
- Processus isobare
- Une transformation qui s'effectue à pression constante.
- Processus isochore
- Une transformation qui s'effectue à volume constant.
- Rendement thermique (\(\eta\))
- Rapport entre le travail mécanique net fourni par le moteur et la quantité de chaleur apportée par la combustion du carburant. Il mesure l'efficacité de la conversion de chaleur en travail.
D’autres exercices de Thermodynamique:
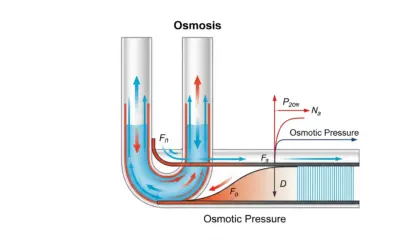
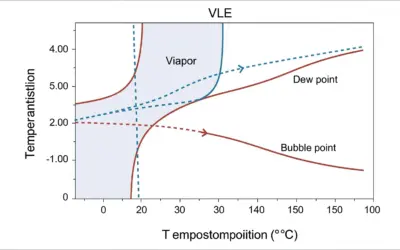
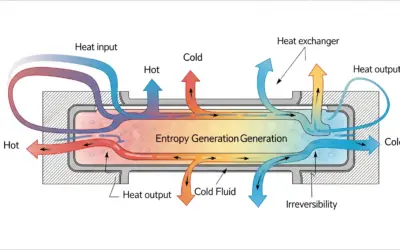
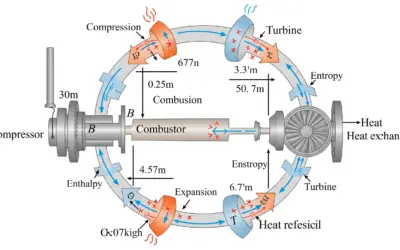
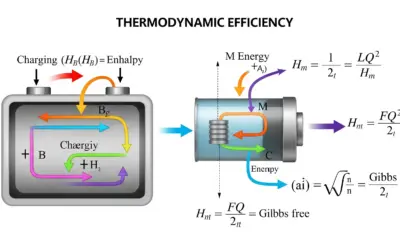
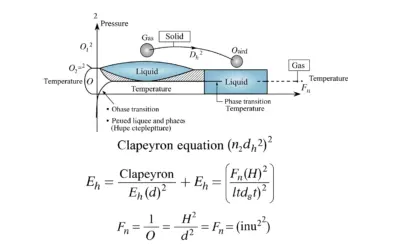
0 commentaires