Conduction Thermique avec Source de Chaleur Interne
Contexte : Le transfert thermiqueDiscipline de la physique traitant des échanges d'énergie thermique entre systèmes. dans les solides.
Nous étudions un mur plan de grande dimension, considéré comme infini dans les directions y et z. Ce mur génère de la chaleur de manière uniforme dans tout son volume (par exemple, par effet Joule dans un matériau conducteur ou par réaction nucléaire dans le cœur d'un réacteur). Les deux faces externes du mur sont maintenues à une température constante, assurant le refroidissement.
Remarque Pédagogique : Cet exercice classique de la thermodynamique est fondamental pour comprendre comment la température se distribue dans un matériau qui génère sa propre chaleur. Il vous apprendra à poser et résoudre l'équation de la chaleur en régime stationnaire avec un terme source.
Objectifs Pédagogiques
- Poser l'équation de la chaleur en 1D stationnaire avec source interne.
- Définir et appliquer les conditions aux limites appropriées (symétrie, température imposée).
- Résoudre l'équation différentielle pour obtenir le profil de température \( T(x) \).
- Calculer la température maximale atteinte dans le matériau.
- Calculer le flux thermiqueQuantité d'énergie thermique transférée par unité de surface et par unité de temps (en W/m²). évacué aux surfaces.
Données de l'étude
Fiche Technique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Géométrie | Mur plan, "infini" |
| Régime | Stationnaire (permanent) |
| Dimensions de l'étude | Unidimensionnelle (1D) selon l'axe \( x \) |
Modélisation du Mur Plan avec Source
| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Épaisseur totale du mur | \( 2L \) | 10 | cm |
| Source de chaleur volumique | \( q_v \) (ou \( \dot{q} \)) | 500 | kW/m³ |
| Conductivité thermiquePropriété d'un matériau à transférer la chaleur par conduction. (en W/m·K) | \( k \) | 20 | W/m·K |
| Température de surface | \( T_s \) | 80 | °C |
Questions à traiter
- Établir l'équation différentielle qui régit le profil de température \( T(x) \).
- Définir les conditions aux limites nécessaires pour résoudre cette équation.
- Résoudre l'équation pour trouver l'expression littérale du profil de température \( T(x) \).
- Calculer la température maximale \( T_{max} \) au sein du mur.
- Calculer le flux de chaleur \( \phi(L) \) à la surface \( x = L \).
Les bases sur la Conduction Thermique
La conduction est un mode de transfert de chaleur au sein d'un milieu (solide ou fluide au repos) sans déplacement de matière, dû à l'agitation moléculaire.
1. Loi de Fourier (1D)
Elle lie le flux thermiqueQuantité d'énergie thermique transférée par unité de surface et par unité de temps (en W/m²). \( \phi \) au gradient de température :
\[ \phi(x) = -k \frac{dT}{dx} \]
Le signe 'moins' indique que la chaleur s'écoule des zones chaudes vers les zones froides (dans le sens opposé du gradient).
2. Équation de la chaleur (1D, stationnaire)
Elle provient d'un bilan d'énergie sur un volume élémentaire. En régime stationnaire, la variation d'énergie interne est nulle. Le bilan s'écrit :
\[ (\text{Flux entrant}) - (\text{Flux sortant}) + (\text{Génération interne}) = 0 \]
Ceci conduit à l'équation générale :
\[ \frac{d}{dx} \left( k \frac{dT}{dx} \right) + q_v = 0 \]
Correction : Conduction Thermique avec Source de Chaleur Interne
Question 1 : Établir l'équation différentielle qui régit le profil de température \( T(x) \).
Principe
Le principe fondamental est la conservation de l'énergie appliquée à un petit volume de matière en régime stationnaire. En l'absence de variation temporelle, toute l'énergie qui entre dans le volume (par conduction ou génération interne) doit en ressortir (par conduction). Mathématiquement, cela se traduit par un bilan nul sur ce volume.
Mini-Cours
Le flux thermique \( \phi(x) \) (en W/m²) représente l'énergie traversant une surface unité par seconde. La quantité d'énergie entrant par conduction en \( x \) sur une surface \( A \) est \( \phi(x) \cdot A \). Celle sortant en \( x+dx \) est \( \phi(x+dx) \cdot A \). L'énergie générée dans le volume \( A \cdot dx \) est \( q_v \cdot A \cdot dx \). Le bilan \( \phi(x)A - \phi(x+dx)A + q_v A dx = 0 \) mène, après division par \( A dx \) et passage à la limite \( dx \to 0 \), à \( -\frac{d\phi}{dx} + q_v = 0 \). En remplaçant \( \phi \) par la loi de Fourier, on obtient l'équation générale.
Remarque Pédagogique
L'étape clé est de bien comprendre le bilan : ce qui entre moins ce qui sort, plus ce qui est créé = accumulation (nulle ici car stationnaire). Ne pas oublier le signe moins dans la loi de Fourier est essentiel. Visualiser le flux comme un "courant" de chaleur peut aider.
Normes
Cette approche basée sur les bilans d'énergie est fondamentale en thermodynamique et transferts thermiques. Elle ne découle pas d'une norme spécifique (comme les Eurocodes en structure), mais des principes physiques généraux.
Formule(s)
Équation générale (1D, stationnaire)
Cas \( k \) constant
Hypothèses
Pour simplifier l'équation générale en \( \frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q_v}{k} \), on suppose :
- Régime stationnaire : La température ne dépend pas du temps (\( \partial T / \partial t = 0 \)).
- Conduction unidimensionnelle : La température ne varie que selon l'axe \( x \) (\( T=T(x) \)). Cela est justifié par la grande étendue du mur dans les autres directions.
- Conductivité thermique constante : \( k \) ne dépend ni de la position \( x \) ni de la température \( T \). C'est souvent une approximation raisonnable pour des variations de température modérées.
- Source interne uniforme : \( q_v \) est constant dans tout le volume.
Donnée(s)
Les concepts physiques utilisés sont la conductivité et la source interne.
| Paramètre | Symbole | Description |
|---|---|---|
| Conductivité Thermique | \( k \) | Capacité du matériau à conduire la chaleur |
| Source Volumique | \( q_v \) | Chaleur générée par unité de volume |
Astuces
Rappelez-vous que \( \frac{d^2T}{dx^2} \) représente la courbure (concavité) du profil. Un signe négatif (\( -q_v/k \)) signifie que la courbe est "tournée vers le bas", comme une parabole \( y = -ax^2 \).
Schéma (Avant les calculs)
Visualisation du bilan énergétique sur une tranche infinitésimale \( dx \) du mur.
Bilan d'énergie sur dx
Calcul(s)
On part de l'équation générale et on utilise l'hypothèse \( k = \text{constante} \) pour la sortir de la dérivée :
Cette équation montre que la courbure (dérivée seconde) du profil de température est constante et négative (car \(q_v > 0\) et \(k > 0\)).
Schéma (Après les calculs)
Illustration de la concavité négative du profil \( T(x) \) imposée par le terme source positif (\( q_v > 0 \)). Le profil aura la forme d'une parabole "triste".
Concavité du profil T(x)
Réflexions
L'équation obtenue est une équation différentielle ordinaire (EDO) du second ordre, linéaire, à coefficients constants. Sa résolution nécessitera deux constantes d'intégration.
Points de vigilance
Ne pas confondre avec l'équation en régime transitoire, qui inclut un terme de dérivée temporelle (\( \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \)), ou avec les équations en coordonnées cylindriques ou sphériques qui ont des formes différentes.
Points à retenir
L'équation \( \frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q_v}{k} \) est le point de départ fondamental pour l'étude de la conduction 1D stationnaire avec source interne et conductivité constante.
Le saviez-vous ?
Cette équation est une forme simplifiée de l'équation de la chaleur, dont la forme générale a été établie par Jean-Baptiste Joseph Fourier au début du XIXe siècle dans son ouvrage "Théorie analytique de la chaleur".
FAQ
Il est normal d'avoir des questions.
Résultat Final
A vous de jouer
Calculez la valeur numérique du terme \( -q_v / k \) avec les unités du SI (W, m, K). Attention aux conversions !
Question 2 : Définir les conditions aux limites nécessaires pour résoudre cette équation.
Principe
L'équation \( \frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q_v}{k} \) est une EDO (Équation Différentielle Ordinaire) du second ordre. Mathématiquement, sa solution générale contiendra deux constantes indéterminées (issues des deux intégrations successives). Pour trouver la solution unique correspondant à notre problème physique, il faut deux informations supplémentaires sur la température ou son gradient à des points spécifiques du domaine : ce sont les conditions aux limites (CL).
Mini-Cours
Les CL traduisent l'interaction du système étudié avec son environnement ou des propriétés intrinsèques du système :
- Température imposée (Type Dirichlet) : La valeur de \( T \) est connue à une frontière \( x_0 \). Ex: \( T(L) = T_s \). Cela arrive lorsqu'une surface est en contact avec un thermostat ou un fluide à température constante avec un échange très efficace.
- Flux imposé (Type Neumann) : La valeur du flux \( \phi \) (donc de \( -k \frac{dT}{dx} \)) est connue à une frontière \( x_0 \). Ex: \( -k \frac{dT}{dx}(x_0) = \phi_0 \). Un cas particulier important est la surface adiabatique (parfaitement isolée), où le flux est nul : \( \phi = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx}(x_0) = 0 \).
- Symétrie : Si le problème présente une symétrie géométrique et thermique par rapport à un plan (ici \( x=0 \)), le profil de température doit être symétrique et le flux thermique doit être nul sur ce plan. Donc \( \frac{dT}{dx}(0) = 0 \). C'est un cas particulier de flux imposé nul.
Remarque Pédagogique
Le choix des CL est fondamental et doit être justifié physiquement. Dans notre cas, l'énoncé indique explicitement que les surfaces sont maintenues à \( T_s \), ce qui impose une CL de type Dirichlet en \( x=L \) (et \( x=-L \)). La géométrie et la source uniforme suggèrent une symétrie par rapport au centre \( x=0 \), fournissant la seconde CL (type Neumann spécifique : flux nul).
Hypothèses
Pour définir les CL, nous utilisons les hypothèses suivantes basées sur l'énoncé et la physique :
- Contact parfait aux surfaces : On suppose que la température du matériau aux surfaces \( x=\pm L \) est exactement égale à la température imposée \( T_s \).
- Symétrie thermique : La géométrie (mur plan centré), la source (\( q_v \) uniforme) et les conditions de refroidissement (\( T_s \) des deux côtés) sont symétriques par rapport au plan médian \( x=0 \). Cela implique que le profil de température \( T(x) \) est une fonction paire et que le flux thermique est nul en \( x=0 \).
Donnée(s)
Les données pertinentes sont : la position des surfaces (\( \pm L \)), la température imposée \( T_s \) sur ces surfaces, et l'existence d'un plan de symétrie en \( x=0 \).
Astuces
Utiliser la symétrie simplifie souvent le problème en réduisant le domaine d'étude et en fournissant une condition \( \frac{dT}{dx} = 0 \) au centre, ce qui annule directement une constante d'intégration.
Schéma
Visualisation des deux conditions limites sur le domaine d'étude (ici, on choisit \( [0, L] \) grâce à la symétrie).
Domaine d'étude et Conditions Limites
Réflexions
Grâce à la symétrie, nous pouvons résoudre le problème uniquement sur la moitié du mur (par exemple, de \( x=0 \) à \( x=L \)), ce qui simplifie l'analyse. Le profil de température sera une fonction paire (\( T(x) = T(-x) \)).
Points de vigilance
Ne pas appliquer une condition au mauvais endroit (par exemple, \( T=T_s \) en \( x=0 \)). Bien vérifier la définition du système de coordonnées.
Points à retenir
Une EDO du second ordre nécessite deux conditions aux limites. La symétrie thermique implique un flux nul (\( dT/dx = 0 \)) sur le plan de symétrie.
Le saviez-vous ?
Les conditions de Dirichlet (température imposée) et Neumann (flux imposé) sont nommées d'après les mathématiciens Peter Gustav Lejeune Dirichlet et Carl Neumann.
Résultat Final
1. Symétrie (au centre) : \( \frac{dT}{dx} = 0 \) en \( x=0 \).
2. Température imposée (en surface) : \( T = T_s \) en \( x=L \).
Question 3 : Résoudre l'équation pour trouver l'expression littérale du profil de température \( T(x) \).
Principe
Maintenant que nous avons l'équation différentielle (\( \frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q_v}{k} \)) et les deux conditions aux limites (\( \frac{dT}{dx}(0)=0 \) et \( T(L)=T_s \)), nous pouvons trouver l'unique fonction \( T(x) \) qui satisfait les trois. Cela se fait par intégrations successives de l'EDO, en utilisant les CL pour déterminer les constantes d'intégration à chaque étape.
Mini-Cours
La résolution d'une EDO linéaire du second ordre à coefficients constants de la forme \( y'' = A \) (où A est une constante) se fait en intégrant deux fois par rapport à la variable indépendante (ici \( x \)).
- 1ère intégration : \( \int y'' dx = \int A dx \Rightarrow y'(x) = Ax + C_1 \). La constante \( C_1 \) est déterminée par une condition sur la dérivée première \( y' \).
- 2ème intégration : \( \int y' dx = \int (Ax + C_1) dx \Rightarrow y(x) = A\frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2 \). La constante \( C_2 \) est déterminée par une condition sur la fonction \( y \) elle-même.
Remarque Pédagogique
L'ordre d'application des CL est important pour simplifier les calculs. Appliquer la condition sur \( dT/dx \) (ici, la symétrie en \( x=0 \)) juste après la première intégration permet de déterminer \( C_1 \) immédiatement. Appliquer la condition sur \( T \) (ici, \( T(L)=T_s \)) après la seconde intégration permet ensuite de trouver \( C_2 \).
Normes
Pas de norme spécifique, il s'agit d'une technique mathématique standard de résolution d'EDO.
Formule(s)
Équation à résoudre
Conditions aux limites
Hypothèses
On suppose \( q_v \) et \( k \) constants pour que l'intégration soit simple.
Donnée(s)
Les conditions limites déterminées à la question précédente sont les données d'entrée pour cette étape.
| Condition | Position | Valeur |
|---|---|---|
| Symétrie | \( x=0 \) | \( dT/dx = 0 \) |
| Temp. Imposée | \( x=L \) | \( T = T_s \) |
Astuces
Vérifiez toujours que la solution finale satisfait bien l'équation différentielle de départ ET les deux conditions aux limites.
Schéma (Avant les calculs)
Ce schéma rappelle l'objectif : trouver la fonction \( T(x) \) dont la dérivée seconde est constante et négative, et qui respecte les conditions aux points \( x=0 \) (tangente horizontale) et \( x=L \) (valeur \( T_s \)).
Recherche de la fonction T(x)
Calcul(s)
Étape 1 : Première intégration
On intègre l'équation \( \frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q_v}{k} \) par rapport à \( x \). L'intégrale de la dérivée seconde donne la dérivée première, et l'intégrale de la constante \( -q_v/k \) donne \( (-q_v/k)x \) plus une constante d'intégration \( C_1 \).
Étape 2 : Détermination de \( C_1 \) avec CL1 (\( \frac{dT}{dx}(0) = 0 \))
On applique la condition de symétrie : le gradient de température doit être nul au centre (\( x=0 \)).
La constante \( C_1 \) est donc nulle. L'expression du gradient devient \( \frac{dT}{dx}(x) = -\frac{q_v}{k} x \).
Étape 3 : Seconde intégration (avec \( C_1=0 \))
On intègre l'expression du gradient \( \frac{dT}{dx}(x) = -\frac{q_v}{k} x \) par rapport à \( x \). L'intégrale de la dérivée première donne la fonction \( T(x) \), et l'intégrale de \( (-q_v/k)x \) donne \( (-q_v/k)\frac{x^2}{2} \) plus une nouvelle constante d'intégration \( C_2 \).
Étape 4 : Détermination de \( C_2 \) avec CL2 (\( T(L) = T_s \))
On applique la condition de température imposée à la surface \( x=L \).
Étape 5 : Expression finale de \( T(x) \)
On remplace la valeur de \( C_2 \) trouvée dans l'expression de \( T(x) \) de l'étape 3 et on réarrange pour une forme plus lisible.
Schéma (Après les calculs)
Le profil de température est parabolique, symétrique, avec un maximum en \( x=0 \) et atteignant \( T_s \) en \( x=\pm L \).
Profil de Température Parabolique T(x)
Réflexions
On peut réécrire le résultat sous la forme \( T(x) = T_s + \frac{q_v L^2}{2k} \left(1 - \left(\frac{x}{L}\right)^2\right) \). On voit que la température est la somme de la température de surface \( T_s \) et d'un "excès" de température dû à la source interne, qui est de forme parabolique.
Points de vigilance
Ne pas oublier le facteur \( 1/2 \) lors de la seconde intégration de \( x \). Vérifier les signes lors de la détermination de \( C_2 \).
Points à retenir
La solution pour la conduction 1D stationnaire avec source uniforme, \( k \) constant et températures de surface égales est toujours une parabole de la forme \( T(x) = T_s + \frac{q_v}{2k} (L^2 - x^2) \).
Le saviez-vous ?
Cette forme parabolique se retrouve dans d'autres phénomènes physiques décrits par des équations similaires (équation de Poisson), comme le potentiel électrostatique dans une plaque avec une densité de charge uniforme.
FAQ
...
Résultat Final
A vous de jouer
En utilisant l'expression littérale \( T(x) = T_s + \frac{q_v L^2}{2k} (1 - (x/L)^2) \), que vaut la température \( T(x) \) à mi-chemin, en \( x = L/2 \) ? (Donnez le résultat sous la forme \( T_s + C \cdot \Delta T_{max} \) où \( \Delta T_{max} = \frac{q_v L^2}{2k} \) et C est un nombre. Donnez C).
Question 4 : Calculer la température maximale \( T_{max} \) au sein du mur.
Principe
La température maximale se situe là où le gradient de température s'annule (\( \frac{dT}{dx} = 0 \)). Dans notre cas, en raison de la symétrie du problème (géométrie, source, conditions aux limites), ce point est intuitivement et mathématiquement le centre du mur (\( x=0 \)). Il suffit donc d'évaluer l'expression de \( T(x) \) trouvée précédemment en \( x=0 \).
Mini-Cours
La recherche d'extrema (maximum ou minimum) d'une fonction différentiable \( f(x) \) passe par l'étude de sa dérivée première. Les points où \( f'(x) = 0 \) sont des candidats pour être des extrema locaux. L'étude du signe de la dérivée seconde (\( f''(x) \)) permet de déterminer la nature de l'extremum : si \( f''(x_0) < 0 \), c'est un maximum local ; si \( f''(x_0) > 0 \), c'est un minimum local. Ici, \( \frac{d^2T}{dx^2} = -q_v/k < 0 \), confirmant que \( x=0 \) est bien un maximum.
Remarque Pédagogique
Physiquement, le centre \( x=0 \) est le point le plus "difficile" à refroidir car il est le plus éloigné des deux surfaces froides (\( x=\pm L \)). La chaleur générée en \( x=0 \) doit parcourir la plus grande distance pour être évacuée. Il est donc logique que la température y soit maximale.
Normes
Non applicable.
Formule(s)
On part du profil de température \( T(x) = T_s + \frac{q_v}{2k} (L^2 - x^2) \) et on évalue en \( x=0 \).
Hypothèses
Les hypothèses sont les mêmes que celles qui ont permis d'établir l'expression de \( T(x) \):
- Régime stationnaire, conduction 1D.
- \( k \) et \( q_v \) constants.
- Symétrie thermique et géométrique par rapport à \( x=0 \).
- Température \( T_s \) imposée en \( x=\pm L \).
Donnée(s)
Nous devons être très attentifs aux unités. Convertissons tout en unités SI (W, m, K, °C).
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité (SI) |
|---|---|---|---|
| Source volumique | \( q_v \) | 500 kW/m³ | \( 500 \times 10^3 = 500 000 \) W/m³ |
| Demi-épaisseur | \( L \) | 5 cm (car 2L = 10 cm) | \( 0.05 \) m |
| Conductivité | \( k \) | 20 | W/m·K |
| Temp. surface | \( T_s \) | 80 | °C |
Astuces
Le terme \( \frac{q_v L^2}{2k} \) représente l'écart de température (\( \Delta T \)) entre le centre et la surface. Il est souvent utile de le calculer séparément avant de l'ajouter à \( T_s \).
Schéma (Avant les calculs)
Le profil parabolique obtenu en Q3 nous montre où chercher le maximum.
Localisation du Maximum de Température
Calcul(s)
Étape 1 : Calcul de l'écart de température \( \Delta T_{max} = T_{max} - T_s \)
On calcule d'abord l'augmentation de température entre la surface et le centre, due à la source interne.
Un écart de 31.25 K est identique à un écart de 31.25 °C.
Étape 2 : Calcul de \( T_{max} \)
On ajoute cet écart à la température de surface pour obtenir la température maximale au centre.
Schéma (Après les calculs)
Annotation du profil de température avec la valeur numérique de \( T_{max} \) calculée.
Profil avec Tmax Calculée
Réflexions
La température au cœur du matériau est significativement plus élevée que sur les bords à cause de la génération interne. Cet écart dépend fortement de la source \( q_v \), de l'épaisseur \( L \) (au carré !) et inversement de la conductivité \( k \).
Points de vigilance
L'erreur la plus commune est l'oubli de la conversion des unités. Utiliser \( q_v = 500 \) (au lieu de 500 000) ou \( L = 10 \) ou \( L = 5 \) (au lieu de 0.05) sont des pièges classiques. N'oubliez pas que \( L \) est la demi-épaisseur !
Points à retenir
Le maximum de température dans un mur plan symétrique avec source interne est au centre (\( x=0 \)) et sa valeur est \( T_{max} = T_s + \frac{q_v L^2}{2k} \).
Le saviez-vous ?
Dans les barres de combustible nucléaire (souvent cylindriques), le calcul de la température maximale au centre est crucial pour éviter la fusion du combustible. L'équation et la démarche sont similaires, mais en coordonnées cylindriques.
FAQ
...
Résultat Final
A vous de jouer
Si la conductivité \( k \) était deux fois plus élevée (\( k = 40 \) W/m·K), quelle serait la nouvelle température maximale ? (Tous les autres paramètres inchangés).
Question 5 : Calculer le flux de chaleur \( \phi(L) \) à la surface \( x = L \).
Principe
Le flux de chaleur par conduction est donné par la Loi de Fourier : \( \phi = -k \frac{dT}{dx} \). Pour trouver le flux à une position spécifique (ici, la surface \( x=L \)), il faut connaître la conductivité \( k \) et la valeur du gradient de température \( \frac{dT}{dx} \) à cette position précise. Nous avons déjà déterminé l'expression générale de \( \frac{dT}{dx}(x) \) lors de la résolution de l'EDO.
Mini-Cours
La Loi de Fourier (\( \phi = -k \frac{dT}{dx} \)) est locale : le flux en un point \( x \) ne dépend que des propriétés (\( k \)) et du gradient de température (\( dT/dx \)) en ce même point. Le signe moins est crucial : si la température diminue lorsque \( x \) augmente (\( dT/dx < 0 \)), le flux est positif (dirigé vers les \( x \) croissants), et vice-versa. Cela assure que la chaleur s'écoule toujours du chaud vers le froid.
Remarque Pédagogique
Ne confondez pas le flux thermique \( \phi \) (en W/m², une densité surfacique de puissance) avec la puissance thermique totale \( \Phi \) (en W) traversant une surface \( A \), qui vaut \( \Phi = \phi \cdot A \). Ici, on calcule \( \phi \). Notez que le flux \( \phi(x) \) n'est pas constant dans ce cas, car la chaleur générée en continu doit être évacuée.
Normes
Non applicable.
Formule(s)
Loi de Fourier
Gradient de température (de Q3, Étape 2, avec \( C_1=0 \))
Hypothèses
Mêmes hypothèses que précédemment (\( k \) constant, etc.).
Donnée(s)
Les données nécessaires sont celles utilisées pour calculer \( dT/dx \) à la position \( x=L \).
| Paramètre | Symbole | Valeur (SI) |
|---|---|---|
| Source Volumique | \( q_v \) | 500 000 W/m³ |
| Conductivité | \( k \) | 20 W/m·K |
| Position | \( x \) | \( L = 0.05 \) m |
Astuces
On peut aussi trouver le flux en faisant un bilan global sur la moitié du mur [0, L]. L'énergie générée dans ce volume (\( q_v \times A \times L \)) doit être évacuée par la surface en \( x=L \) (flux \( \phi(L) \times A \)). En simplifiant par \( A \), on obtient \( \phi(L) = q_v L \). C'est une excellente façon de vérifier le résultat obtenu par la Loi de Fourier.
Schéma (Avant les calculs)
Visualisation du gradient \( dT/dx \) à la surface \( x=L \). Il est négatif, car la température diminue vers l'extérieur. Le flux \( \phi(L) \), proportionnel à \( -dT/dx \), sera donc positif (sortant).
Gradient dT/dx et Flux ϕ en x=L
Calcul(s)
Étape 1 : Expression littérale de \( \phi(x) \)
On remplace l'expression du gradient \( \frac{dT}{dx}(x) = -\frac{q_v}{k} x \) dans la loi de Fourier.
Note : Le flux est linéaire et nul au centre (\( \phi(0)=0 \)), ce qui est logique par symétrie.
Étape 2 : Calcul de \( \phi(L) \) à la surface
On évalue l'expression de \( \phi(x) \) à la position \( x=L \) et on fait l'application numérique avec les valeurs SI.
Schéma (Après les calculs)
Profil linéaire du flux thermique \( \phi(x) = q_v x \), allant de \( -q_v L \) en \( x=-L \) à \( +q_v L \) en \( x=+L \).
Profil Linéaire du Flux Thermique ϕ(x)
Réflexions
Interprétation physique : Le flux à la surface \( \phi(L) = q_v L \) représente toute l'énergie générée dans la moitié du mur (volume \( A \cdot L \), génération \( q_v \cdot A \cdot L \)). Cette énergie doit être évacuée par la surface (flux \( \phi(L) \cdot A \)). En divisant par A, on retrouve \( \phi(L) = q_v L \). Le bilan est respecté !
Points de vigilance
Attention au signe. Le flux \( \phi(L) \) est positif, ce qui signifie qu'il est dirigé selon l'axe \( +x \) (vers l'extérieur), ce qui est cohérent pour une évacuation de chaleur.
Points à retenir
Le flux de chaleur dans un mur plan avec source uniforme varie linéairement avec la position \( x \), et est nul au centre en cas de symétrie. Sa valeur en surface \( x=L \) est \( \phi(L) = q_v L \).
Le saviez-vous ?
Le concept de flux thermique est analogue au courant électrique (loi d'Ohm) ou au débit de fluide (loi de Darcy), où un "gradient" (de température, de potentiel, de pression) génère un "flux".
FAQ
...
Résultat Final
A vous de jouer
Que vaudrait le flux de chaleur à la surface opposée, en \( x = -L \) ? (Attention au signe, le flux est un vecteur).
Outil Interactif : Simulateur de Mur Plan
Utilisez les curseurs pour voir comment la source de chaleur et la conductivité influencent la température maximale et le flux en surface. (\( L=0.05 \)m et \( T_s=80 \)°C sont fixes).
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Le profil de température dans un mur plan avec source uniforme (\( q_v > 0 \)) et \( k \) constant est :
2. Pour un mur symétriquement refroidi, où la température est-elle maximale ?
3. Pour un mur symétriquement refroidi, où le flux de chaleur \( \phi \) est-il nul ?
4. Si on double la source de chaleur \( q_v \), l'écart de température \( (T_{max} - T_s) \) est :
5. Si on double l'épaisseur totale \( 2L \) (donc \( L \) est doublé), l'écart de température \( (T_{max} - T_s) \) est :
Glossaire
- Conduction
- Transfert d'énergie thermique par interactions directes (collisions, vibrations) entre particules adjacentes, sans mouvement macroscopique de matière.
- Conductivité thermique (\( k \))
- Propriété d'un matériau à transférer la chaleur par conduction. Une \( k \) élevée (ex: métaux) signifie un bon conducteur. Unité : W/m·K.
- Flux thermique (\( \phi \))
- Quantité d'énergie thermique (chaleur) qui traverse une surface par unité de temps et par unité de surface. Unité : W/m².
- Régime stationnaire (ou permanent)
- État d'un système où les propriétés (comme la température) en tout point ne varient pas au cours du temps. \( \frac{dT}{dt} = 0 \).
- Source de chaleur interne (\( q_v \))
- Taux de génération d'énergie thermique par unité de volume au sein même du matériau. Unité : W/m³.
D’autres exercices de Thermodynamique:
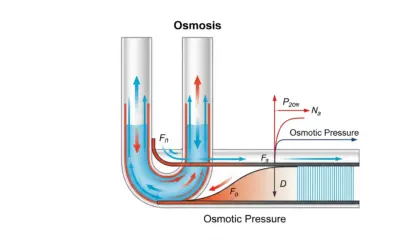
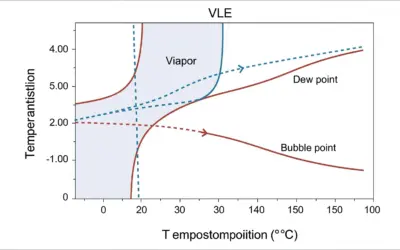
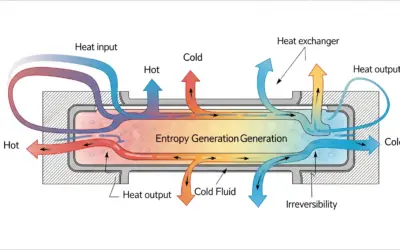
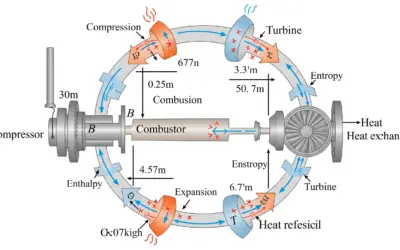
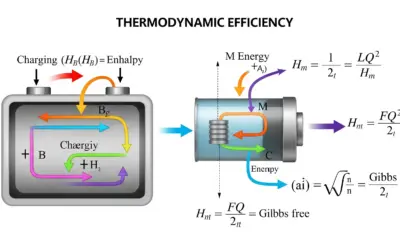
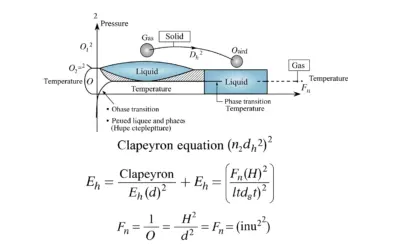
0 commentaires