Étude du Cycle de Carnot d’un Gaz Parfait
Contexte : Le Cycle de CarnotUn cycle thermodynamique théorique, réversible, composé de quatre transformations, qui établit le rendement maximal qu'un moteur thermique peut atteindre entre deux sources de chaleur..
Le cycle de Carnot est une pierre angulaire de la thermodynamique. Proposé par Sadi Carnot en 1824, ce cycle idéal décrit le fonctionnement d'un moteur thermique ayant le meilleur rendement possible. Il est constitué de quatre transformations réversibles subies par un gaz parfaitUn modèle théorique de gaz où les particules sont supposées n'avoir ni volume propre ni interactions entre elles, obéissant à la loi PV=nRT. : deux transformations isothermes et deux transformations adiabatiques. Cet exercice vous guidera à travers l'analyse complète de ce cycle.
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à décomposer un cycle thermodynamique complexe, à appliquer les lois fondamentales pour chaque type de transformation, et à calculer la performance (rendement) d'un moteur thermique.
Objectifs Pédagogiques
- Identifier et décrire les quatre transformations du cycle de Carnot.
- Appliquer la loi des gaz parfaits et la loi de Laplace dans leurs domaines de validité.
- Calculer le travail et la chaleur échangés pour chaque étape du cycle.
- Déterminer le rendement d'un moteur de Carnot et comprendre les facteurs qui l'influencent.
Données de l'étude
Fiche Technique du Gaz
| Caractéristique | Symbole et Valeur |
|---|---|
| Constante des gaz parfaits | \(R \approx 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |
| Indice adiabatique (gaz monoatomique) | \(\gamma = C_p/C_v = 5/3\) |
| Capacité thermique à volume constant | \(C_v = \frac{3}{2}R\) |
Diagramme de Clapeyron (P-V)
Questions à traiter
- Détermination des états : Calculer les variables d'état (Pression, Volume) pour les points B, C et D.
- Analyse des transformations : Pour chaque transformation (A-B, B-C, C-D, D-A), calculer le travail \(W\) et la quantité de chaleur \(Q\) échangés par le gaz.
- Bilan du cycle : Calculer le travail total \(W_{\text{cycle}}\) reçu par le gaz et la chaleur totale \(Q_{\text{cycle}}\) sur un cycle complet.
- Calcul du rendement : Déterminer le rendement \(\eta\) de ce moteur thermique.
- Comparaison théorique : Comparer le rendement calculé avec le rendement théorique de Carnot. Conclure.
Les bases de la Thermodynamique
Pour résoudre cet exercice, plusieurs concepts et formules sont nécessaires.
1. Premier principe de la thermodynamique
La variation de l'énergie interne \(\Delta U\) d'un système est égale à la somme du travail \(W\) et de la chaleur \(Q\) échangés avec l'extérieur :
\[ \Delta U = W + Q \]
Pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne ne dépend que de la température : \(\Delta U = n C_v \Delta T\).
2. Transformations réversibles
- Isotherme (\(T = \text{cste}\)) : \(\Delta U = 0\), donc \(W = -Q\). Le travail vaut \(W = -nRT \ln(V_{\text{final}}/V_{\text{initial}})\).
- Adiabatique (\(Q = 0\)) : \(\Delta U = W\). La transformation suit la loi de Laplace : \(PV^\gamma = \text{cste}\) ou \(TV^{\gamma-1} = \text{cste}\).
3. Rendement d'un moteur thermique
Le rendement \(\eta\) est le rapport entre le travail utile fourni par le cycle (\(|W_{\text{cycle}}|\)) et la chaleur prélevée à la source chaude (\(Q_C\)).
\[ \eta = \frac{|W_{\text{cycle}}|}{Q_C} = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_C} \]
Pour le cycle de Carnot, le rendement théorique ne dépend que des températures des sources :
\[ \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_F}{T_C} \]
Correction : Étude du Cycle de Carnot d’un Gaz Parfait
Question 1 : Détermination des états (P, V)
Principe
Le concept physique est d'utiliser les lois d'état qui régissent le comportement du gaz parfait pour "naviguer" d'un point connu à un point inconnu du cycle. On utilise la loi des gaz parfaits pour se déplacer sur une isotherme et la loi de Laplace pour se déplacer sur une adiabatique.
Mini-Cours
La loi des gaz parfaits (\(PV=nRT\)) lie la pression, le volume et la température d'un gaz. Elle est fondamentale pour déterminer une variable si les deux autres sont connues. La loi de Laplace (\(TV^{\gamma-1} = \text{constante}\)) est spécifique aux transformations adiabatiques réversibles. Elle montre que lors d'une compression adiabatique, le gaz s'échauffe, et lors d'une détente, il se refroidit.
Remarque Pédagogique
Face à un cycle, la stratégie est de partir d'un point entièrement connu (ici, le point A) et de suivre les transformations. Comme il nous manque des informations pour aller de A à B directement, il est judicieux de regarder les autres points et de voir comment on peut les relier à A. L'astuce ici est de voir que A et D sont reliés par une adiabatique, ce qui débloque le problème.
Normes
Il n'y a pas de "norme" réglementaire au sens industriel ici. Nous nous plaçons dans le cadre des principes fondamentaux de la thermodynamique classique, établis par des scientifiques comme Clausius, Kelvin et Carnot lui-même. Ces principes sont les "règles du jeu".
Formule(s)
Loi des gaz parfaits
Loi de Laplace (forme T-V)
Donnée(s)
Les données suivantes sont extraites de l'énoncé de l'exercice.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| État A | \(P_A, V_A, T_C\) | 10 bar, 6.65 L, 800 K | - |
| État C | \(V_C, T_F\) | 50 L, 400 K | - |
| Constantes | \(n, R, \gamma\) | 1 mol, 8.314 J·mol⁻¹·K⁻¹, 5/3 | - |
Astuces
Pour un cycle de Carnot, il existe une relation simple entre les volumes aux quatre coins du cycle : \(V_B/V_A = V_C/V_D\). Une fois que vous avez calculé les quatre volumes, vous pouvez utiliser cette égalité pour vérifier la cohérence de vos résultats.
Schéma (Avant les calculs)
Diagramme P-V du cycle à compléter
Calcul(s)
Calcul du volume au point D (\(V_D\))
On utilise la relation adiabatique entre A (\(T_C\)) et D (\(T_F\)) : \(T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \Rightarrow T_C V_A^{\gamma-1} = T_F V_D^{\gamma-1}\)
Calcul de la pression au point D (\(P_D\))
Calcul de la pression au point C (\(P_C\))
Calcul du volume au point B (\(V_B\))
On utilise la relation adiabatique entre B (\(T_C\)) et C (\(T_F\)) : \(T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \Rightarrow T_C V_B^{\gamma-1} = T_F V_C^{\gamma-1}\)
Calcul de la pression au point B (\(P_B\))
Schéma (Après les calculs)
Diagramme P-V avec valeurs calculées
Réflexions
Les résultats sont logiques : lors des détentes (A-B et B-C), le volume augmente et la pression diminue. Lors des compressions (C-D et D-A), le volume diminue et la pression augmente. On a bien défini quatre points distincts qui forment un cycle.
Points de vigilance
La principale source d'erreur est la gestion des unités. Il faut être rigoureux et tout convertir en unités du Système International (Pascals, m³, Joules, Kelvin) pour les calculs. L'autre piège est de se tromper dans l'exposant de la loi de Laplace : c'est bien \(1/(\gamma-1)\).
Points à retenir
Pour déterminer les états d'un cycle thermodynamique, la méthode consiste à :
- Identifier les transformations (isotherme, adiabatique, etc.).
- Appliquer la loi d'état correspondante (Loi des gaz parfaits ou Loi de Laplace) pour passer d'un point à l'autre.
Le saviez-vous ?
Sadi Carnot a publié son travail sur les "machines à feu" en 1824, bien avant que le premier principe de la thermodynamique (conservation de l'énergie) ne soit formellement énoncé par Clausius et Kelvin vers 1850. Il a donc posé les bases de la seconde loi de la thermodynamique de manière intuitive.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Recalculez le volume \(V_D\) si la source chaude était à \(T_C = 1000 \text{ K}\). (Réponse attendue en L)
Question 2 : Calcul de W et Q pour chaque transformation
Principe
Le concept est d'appliquer le premier principe de la thermodynamique (\(\Delta U = W+Q\)) à chaque étape. On calcule d'abord le travail \(W\) avec la formule appropriée au type de transformation, puis on en déduit la chaleur \(Q\) (ou inversement).
Mini-Cours
Le travail des forces de pression \(W = -\int P dV\) représente l'énergie mécanique échangée. Pour une isotherme, il se calcule avec le logarithme du rapport des volumes. Pour une adiabatique, il est plus simple de le calculer via la variation d'énergie interne, car \(Q=0\). La chaleur \(Q\) est l'énergie transférée thermiquement. Pour une isotherme, elle oppose le travail. Pour une adiabatique, elle est nulle par définition.
Remarque Pédagogique
Soyez très attentif aux signes. Par convention, l'énergie reçue par le gaz (travail ou chaleur) est comptée positivement. Un travail \(W < 0\) signifie que le gaz travaille (il se détend et pousse sur l'extérieur). Une chaleur \(Q > 0\) signifie que le gaz reçoit de la chaleur.
Normes
La convention de signe pour le travail (\(W > 0\) si reçu par le système) est la norme recommandée par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA) et est la plus courante en chimie et physique post-bac.
Formule(s)
Pour une transformation isotherme (\(T=\text{cste}\))
Pour une transformation adiabatique (\(Q=0\))
Donnée(s)
Les données suivantes proviennent des résultats de la Question 1.
| Point | P (bar) | V (L) | T (K) |
|---|---|---|---|
| A | 10.00 | 6.65 | 800 |
| B | 3.76 | 17.68 | 800 |
| C | 0.67 | 50.00 | 400 |
| D | 1.77 | 18.81 | 400 |
Astuces
Notez que les travaux des deux transformations adiabatiques (B-C et D-A) sont opposés : \(W_{BC} = -W_{DA}\). C'est parce que la variation de température est la même en valeur absolue mais de signe opposé. C'est un excellent moyen de vérifier vos calculs !
Schéma (Avant les calculs)
Flux d'énergie sur le cycle
Calcul(s)
Calcul pour A \(\rightarrow\) B (Isotherme)
Calcul pour B \(\rightarrow\) C (Adiabatique)
Calcul pour C \(\rightarrow\) D (Isotherme)
Calcul pour D \(\rightarrow\) A (Adiabatique)
Schéma (Après les calculs)
Diagramme P-V avec Bilan Énergétique par Étape
Réflexions
On observe que la chaleur est bien absorbée (\(Q>0\)) sur l'isotherme chaude et rejetée (\(Q<0\)) sur l'isotherme froide. Le travail est bien moteur (\(W<0\)) durant les détentes et résistant (\(W>0\)) durant les compressions.
Points de vigilance
Ne confondez pas le logarithme népérien (ln) avec le logarithme décimal (log). Assurez-vous d'utiliser la bonne température (en Kelvin) pour chaque isotherme. N'oubliez pas le signe "-" dans la formule du travail.
Points à retenir
Maîtrisez les quatre relations clés pour W et Q en fonction du type de transformation. C'est la base de l'analyse de tous les cycles thermodynamiques.
Le saviez-vous ?
L'aire contenue à l'intérieur de la courbe du cycle dans un diagramme P-V est égale à la valeur absolue du travail total échangé au cours du cycle, \(|W_{\text{cycle}}|\). C'est une propriété géométrique très utile.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Calculez le travail \(W_{BC}\) (en J) si le gaz était diatomique (\(C_v = \frac{5}{2}R\)).
Question 3 : Bilan du cycle
Principe
Le concept est de faire la somme algébrique de toutes les énergies (travail et chaleur) échangées sur les quatre étapes pour obtenir le bilan énergétique global du cycle.
Mini-Cours
Le premier principe de la thermodynamique pour un cycle est fondamental : comme le système revient exactement à son état de départ (même P, V, T), son énergie interne n'a pas changé. La variation nette d'énergie interne sur un cycle est donc toujours nulle : \(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\). Par conséquent, on a toujours la relation \(W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = 0\), soit \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\).
Remarque Pédagogique
Utilisez la relation \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\) comme un outil de vérification puissant. Si la somme de vos travaux n'est pas l'opposé de la somme de vos chaleurs, c'est qu'une erreur s'est glissée dans les calculs des étapes précédentes. Prenez le temps de faire cette vérification.
Formule(s)
Travail total sur le cycle
Chaleur totale sur le cycle
Donnée(s)
Les données suivantes sont les résultats des calculs de la Question 2.
| Transformation | Travail (W) en J | Chaleur (Q) en J |
|---|---|---|
| A \(\rightarrow\) B | -6515 | +6515 |
| B \(\rightarrow\) C | -4988 | 0 |
| C \(\rightarrow\) D | +3258 | -3258 |
| D \(\rightarrow\) A | +4988 | 0 |
Schéma (Avant les calculs)
Aire du cycle représentant le travail total
Calcul(s)
Calcul du travail total
Calcul de la chaleur totale
Schéma (Après les calculs)
Bilan énergétique du Moteur de Carnot
Réflexions
Un travail total négatif (\(W_{\text{cycle}} < 0\)) confirme que le cycle est bien un cycle moteur : sur un tour complet, il fournit du travail à l'extérieur. Une chaleur totale positive (\(Q_{\text{cycle}} > 0\)) signifie que le cycle a globalement absorbé de la chaleur pour produire ce travail.
Points de vigilance
Attention aux erreurs d'addition et de signes. C'est une étape simple mais où une inattention peut coûter cher. Pensez à vérifier que les travaux adiabatiques s'annulent, cela simplifie le calcul.
Points à retenir
Pour tout cycle thermodynamique, la variation d'énergie interne est nulle (\(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\)). Le travail total est l'opposé de la chaleur totale (\(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\)).
Le saviez-vous ?
Rudolf Clausius, en s'appuyant sur les travaux de Carnot, est l'un des premiers à avoir formulé le Premier Principe de la Thermodynamique (conservation de l'énergie) et à avoir introduit le concept d'entropie, clé de voûte du Second Principe.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si une machine thermique a absorbé 8000 J de chaleur et en a rejeté 5000 J, quel est le travail total (en J) fourni par le cycle ?
Question 4 : Calcul du rendement
Principe
Le rendement d'un moteur est la mesure de son efficacité : il compare ce qu'on obtient d'utile (le travail mécanique) à ce que l'on a dû "payer" en énergie (la chaleur puisée à la source chaude).
Mini-Cours
La formule du rendement, \(\eta = \frac{\text{Énergie Utile}}{\text{Énergie Coûteuse}}\), est universelle. Pour un moteur thermique, l'énergie utile est le travail fourni, \(|W_{\text{cycle}}| = -W_{\text{cycle}}\). L'énergie coûteuse est la chaleur qu'il a fallu apporter depuis la source chaude, \(Q_C\). C'est uniquement la chaleur absorbée par le système (les termes \(Q>0\)).
Remarque Pédagogique
Ne tombez pas dans le piège d'utiliser la chaleur totale \(Q_{\text{cycle}}\) au dénominateur. Le rendement mesure l'efficacité de la *conversion* de la chaleur entrante en travail. La chaleur rejetée à la source froide est une perte nécessaire, pas une dépense.
Formule(s)
Formule du rendement
Donnée(s)
Les données suivantes proviennent des bilans énergétiques calculés aux Questions 2 et 3.
| Paramètre | Symbole | Valeur (J) |
|---|---|---|
| Travail total du cycle | \(W_{\text{cycle}}\) | -3257 |
| Chaleur absorbée (source chaude) | \(Q_C = Q_{AB}\) | +6515 |
Schéma (Avant les calculs)
Flux pour le calcul du rendement
Calcul(s)
Calcul du rendement
Schéma (Après les calculs)
Visualisation du rendement
Réflexions
Un rendement de 50% signifie que pour 100 Joules de chaleur puisés à la source chaude, ce moteur idéal en transforme 50 en travail mécanique pur. Les 50 autres sont obligatoirement rejetés à la source froide. C'est une conversion déjà très efficace.
Points de vigilance
La principale erreur est de se tromper sur le terme à mettre au dénominateur. C'est TOUJOURS la somme des chaleurs positives (reçues par le système). Ici, il n'y en a qu'une : \(Q_{AB}\).
Points à retenir
Le rendement d'un moteur thermique est défini par \(\eta = -W_{\text{cycle}} / Q_{\text{chaude}}\). Il est toujours inférieur à 1 (ou 100%).
Le saviez-vous ?
Les meilleurs moteurs de voitures à essence ont un rendement réel qui peine à dépasser 35%. Les pertes par frottement, les transferts de chaleur non idéaux et les combustions incomplètes expliquent cette différence avec le rendement théorique de Carnot.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Une machine produit 2000 J de travail en consommant 5000 J de chaleur. Quel est son rendement (en %) ?
Question 5 : Comparaison théorique
Principe
Le concept clé est que le cycle de Carnot représente une limite théorique indépassable. Son rendement, qui ne dépend que des températures des sources, est le maximum qu'un moteur peut atteindre. On compare notre résultat à cette limite.
Mini-Cours
Le théorème de Carnot, une conséquence du second principe de la thermodynamique, énonce que tous les moteurs réversibles fonctionnant entre deux mêmes sources de chaleur ont le même rendement, et que tout moteur irréversible a un rendement inférieur. Ce rendement maximal est \(\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_F/T_C\).
Remarque Pédagogique
Cette dernière question est une validation de l'ensemble de l'exercice. Si votre rendement calculé à la question 4 (basé sur W et Q) correspond au rendement théorique de Carnot, cela prouve que le cycle était bien réversible et que vos calculs sont cohérents.
Formule(s)
Rendement théorique de Carnot
Donnée(s)
Les données suivantes sont les températures des sources, extraites de l'énoncé.
| Paramètre | Symbole | Valeur (K) |
|---|---|---|
| Température source chaude | \(T_C\) | 800 |
| Température source froide | \(T_F\) | 400 |
Schéma (Avant les calculs)
Cadre théorique du Moteur de Carnot
Calcul(s)
Calcul du rendement théorique
Schéma (Après les calculs)
Comparaison des rendements
Réflexions
Le rendement calculé (\(\approx 50\%\)) est identique au rendement théorique (50%). Cette égalité confirme que le cycle étudié, avec ses transformations réversibles, est bien un cycle de Carnot idéal. Tout moteur réel fonctionnant entre 400 K et 800 K aura un rendement inférieur à 50%.
Points de vigilance
L'erreur la plus grave et la plus fréquente est d'oublier de convertir les températures en Kelvin ! La formule du rendement de Carnot n'est valide qu'avec des températures absolues.
Points à retenir
Le rendement de Carnot \(\eta = 1 - T_F/T_C\) est le rendement maximal théorique pour un moteur fonctionnant entre deux sources de chaleur. Il ne peut être atteint que par un cycle réversible.
Le saviez-vous ?
Le concept du rendement de Carnot est à la base de l'échelle de température Kelvin. Le zéro absolu (0 K) est défini comme la température de la source froide qui permettrait à un moteur de Carnot d'avoir un rendement de 1 (ou 100%).
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Quel est le rendement maximal (en %) d'un moteur fonctionnant entre de l'eau bouillante (100 °C) et de la glace fondante (0 °C) ? N'oubliez pas de convertir les températures !
Outil Interactif : Simulateur de Rendement
Utilisez les curseurs pour faire varier les températures des sources chaude et froide et observez leur impact sur le rendement du cycle de Carnot.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Quelles sont les quatre transformations successives du cycle de Carnot ?
2. Durant quelles étapes le système échange-t-il de la chaleur avec les sources ?
3. Le rendement d'un moteur de Carnot dépend...
4. Si on augmente la température de la source chaude (\(T_C\)) en gardant \(T_F\) constante, le rendement du cycle...
Glossaire
- Cycle de Carnot
- Un cycle thermodynamique théorique, réversible, composé de quatre transformations, qui établit le rendement maximal qu'un moteur thermique peut atteindre entre deux sources de chaleur.
- Gaz Parfait
- Un modèle théorique de gaz où les particules sont supposées n'avoir ni volume propre ni interactions entre elles, obéissant à la loi PV=nRT.
- Transformation Isotherme
- Une transformation qui s'effectue à température constante (\(T = \text{cste}\)).
- Transformation Adiabatique
- Une transformation qui s'effectue sans aucun échange de chaleur avec l'extérieur (\(Q = 0\)).
- Rendement (\(\eta\))
- Pour un moteur, c'est le rapport entre l'énergie utile (le travail fourni) et l'énergie coûteuse (la chaleur prélevée à la source chaude).
D’autres exercices de thermodynamique:
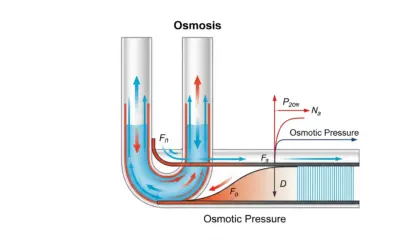
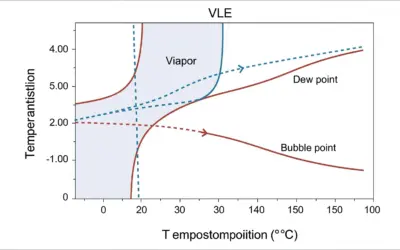
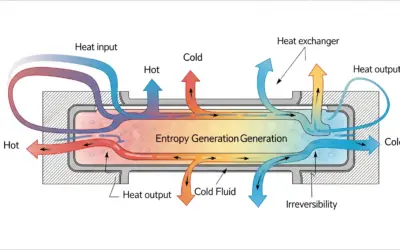
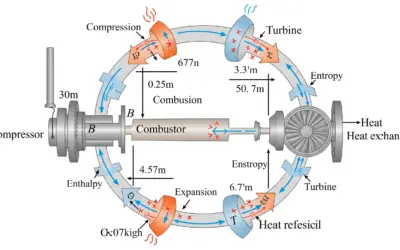
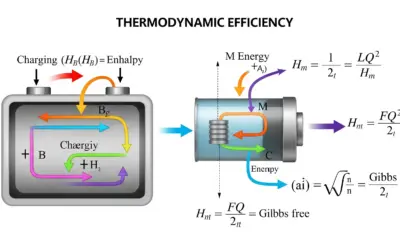
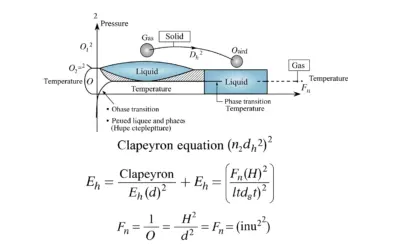
0 commentaires