Machine thermique ditherme Idéale : Le Cycle de Carnot
Contexte : La Machine thermique dithermeUne machine qui échange de la chaleur avec deux sources à températures distinctes (T_chaude et T_froide) pour produire du travail au cours d'un cycle..
Les machines thermiques, comme les moteurs de voiture ou les centrales électriques, sont au cœur de notre société technologique. Elles convertissent de la chaleur, une forme d'énergie "désordonnée", en travail mécanique, une forme d'énergie "ordonnée". Pour comprendre leur fonctionnement, on utilise des modèles thermodynamiques. Le plus célèbre est le cycle de Carnot, qui, bien qu'idéal et inatteignable en pratique, représente la limite théorique absolue de l'efficacité pour toute machine fonctionnant entre deux sources de chaleur données.
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra d'appliquer les premier et second principes de la thermodynamique à un cas concret. En décomposant le cycle de Carnot étape par étape, vous maîtriserez le calcul des grandeurs énergétiques (travail, chaleur) pour des transformations fondamentales et comprendrez la notion cruciale de rendement.
Objectifs Pédagogiques
- Appliquer le premier principe de la thermodynamique sur un cycle moteur complet.
- Calculer le travail et la chaleur échangés lors des transformations isothermes et adiabatiques d'un gaz parfait.
- Déterminer le rendement thermique d'un moteur.
- Comprendre l'importance du rendement de Carnot comme limite supérieure de l'efficacité.
Données de l'étude
Fiche Technique du Fluide
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Constante des gaz parfaits (\(R\)) | \(8.314 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |
| Capacité thermique molaire à volume constant (\(C_{V,m}\)) | \(\frac{3}{2} R\) |
| Indice adiabatique (\(\gamma = C_P/C_V\)) | \(5/3\) |
Diagramme de Clapeyron (P-V) du Cycle de Carnot
| Paramètre | Description | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| \(T_{\text{chaude}}\) | Température de la source chaude | 600 | K |
| \(T_{\text{froide}}\) | Température de la source froide | 300 | K |
| \(V_A\) | Volume du gaz au point A | 10 | L |
| \(V_B\) | Volume du gaz au point B | 20 | L |
Questions à traiter
- Détente isotherme (A → B) : Calculer le travail \(W_{AB}\) et la quantité de chaleur \(Q_{AB}\) échangés par le gaz.
- Détente adiabatique (B → C) : Calculer le volume \(V_C\) en fin de détente. En déduire le travail \(W_{BC}\) échangé. Quelle est la chaleur \(Q_{BC}\) ?
- Compression isotherme (C → D) : Calculer le volume \(V_D\). En déduire le travail \(W_{CD}\) et la chaleur \(Q_{CD}\) échangés.
- Compression adiabatique (D → A) : Calculer le travail \(W_{DA}\) échangé. Quelle est la chaleur \(Q_{DA}\) ?
- Bilan du cycle : Calculer le travail total \(W_{\text{cycle}}\) fourni par le moteur et la chaleur totale \(Q_{\text{chaud}}\) puisée à la source chaude. En déduire le rendement \(\eta\) du moteur et le comparer au rendement théorique de Carnot \(\eta_{\text{th}}\).
Les bases de la Thermodynamique pour les Cycles
Pour résoudre cet exercice, quelques concepts et formules clés de la thermodynamique des gaz parfaits sont nécessaires.
1. Premier Principe de la Thermodynamique
La variation de l'énergie interne \(\Delta U\) d'un système est égale à la somme du travail \(W\) et de la chaleur \(Q\) échangés : \(\Delta U = W + Q\). Pour un cycle complet, le système revient à son état initial, donc \(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\), ce qui implique que \(W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = 0\). Pour un gaz parfait, \(\Delta U = n C_{V,m} \Delta T\).
2. Transformations Thermodynamiques
- Isotherme (\(T=\text{cste}\)) : La température ne varie pas. Pour un gaz parfait, \(\Delta U = 0\). Le travail vaut \(W = -nRT \ln(V_{\text{final}}/V_{\text{initial}})\).
- Adiabatique (\(Q=0\)) : Aucun échange de chaleur avec l'extérieur. Le travail est égal à la variation d'énergie interne \(W = \Delta U\). Les états initial et final sont liés par les lois de Laplace, notamment \(T V^{\gamma-1} = \text{cste}\).
Correction : Machine thermique ditherme Idéale : Le Cycle de Carnot
Question 1 : Détente isotherme (A → B)
Principe
La transformation est isotherme : la température du gaz reste constante (\(T_{\text{chaude}}=600\text{ K}\)). Le gaz se détend, il pousse sur le piston et produit donc du travail. Pour que sa température ne chute pas, il doit simultanément absorber une quantité équivalente de chaleur depuis la source chaude. Pour un gaz parfait, si T est constante, l'énergie interne U ne varie pas.
Mini-Cours
Le premier principe de la thermodynamique stipule que \(\Delta U = W + Q\). Pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne \(\Delta U\) ne dépend que de la variation de température : \(\Delta U = nC_{V,m}\Delta T\). Lors d'une transformation isotherme, \(\Delta T = 0\), donc \(\Delta U = 0\). Le premier principe se simplifie alors en \(W + Q = 0\), soit \(Q = -W\).
Remarque Pédagogique
Cette première étape est la "phase moteur" du cycle, là où la chaleur est convertie en travail utile. Soyez toujours attentif aux signes : une détente signifie \(V_{\text{final}} > V_{\text{initial}}\), donc \(\ln(V_f/V_i) > 0\). Le travail \(W\), qui est en \(- \ln(...)\), sera donc négatif. Un travail négatif signifie qu'il est fourni par le système à l'extérieur.
Normes
Il n'y a pas de "norme" réglementaire ici, mais nous suivons la convention de signe de l'UICPA (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée) : le travail \(W\) et la chaleur \(Q\) sont comptés positivement s'ils sont reçus par le système, et négativement s'ils sont fournis par le système.
Formule(s)
Travail d'une transformation isotherme réversible
Premier principe pour cette étape
Hypothèses
- Le fluide est un gaz parfait.
- La transformation est réversible (quasi-statique), ce qui nous permet d'utiliser la formule intégrale du travail.
- Le contact avec la source chaude est parfait, garantissant une température constante.
Donnée(s)
Les données pour cette première étape sont directement issues de l'énoncé de l'exercice.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Nombre de moles | \(n\) | 1 | mol |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| Température source chaude | \(T_{\text{chaude}}\) | 600 | K |
| Volume initial | \(V_A\) | 10 | L |
| Volume final | \(V_B\) | 20 | L |
Astuces
Le rapport des volumes \(V_B/V_A\) est une grandeur sans dimension. Vous n'avez donc pas besoin de convertir les litres en mètres cubes pour le calcul du logarithme, tant que les deux volumes sont dans la même unité. Cela simplifie le calcul.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma de la détente isotherme (A → B)
Calcul(s)
Calcul du travail \(W_{AB}\)
Calcul de la chaleur \(Q_{AB}\)
Schéma (Après les calculs)
Bilan énergétique de l'étape A → B
Réflexions
Le résultat \(W_{AB} < 0\) confirme que le gaz a fourni du travail mécanique à l'extérieur. Le résultat \(Q_{AB} > 0\) confirme que le gaz a puisé de l'énergie thermique dans la source chaude. C'est bien le principe d'un moteur : convertir de la chaleur en travail.
Points de vigilance
- Ne pas oublier le signe "moins" dans la formule du travail.
- Utiliser la température en Kelvin, l'unité absolue indispensable en thermodynamique.
- S'assurer d'utiliser le logarithme népérien (ln) et non le logarithme décimal (log).
Points à retenir
Synthèse de la détente isotherme (gaz parfait) :
- La température est constante, donc l'énergie interne ne varie pas (\(\Delta U=0\)).
- La chaleur absorbée est intégralement convertie en travail fourni : \(Q = -W\).
- Cette étape est la "source de puissance" du cycle.
Le saviez-vous ?
Le concept de cycle idéal a été introduit par l'ingénieur français Sadi Carnot en 1824 dans son ouvrage "Réflexions sur la puissance motrice du feu". Il a démontré, avant même la formulation du premier principe, que l'efficacité d'un moteur dépendait fondamentalement de la différence de température entre ses sources, posant ainsi les bases du second principe de la thermodynamique.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si le volume final \(V_B\) était de 30 L au lieu de 20 L, quel serait le travail \(W_{AB}\) fourni ? (Réponse en J, arrondie à l'entier)
Question 2 : Détente adiabatique (B → C)
Principe
La transformation est adiabatique : le système est thermiquement isolé, il n'échange aucune chaleur avec l'extérieur (\(Q=0\)). Le gaz continue sa détente et fournit du travail. Comme aucune chaleur ne peut entrer pour compenser cette perte d'énergie, le gaz doit puiser dans sa propre énergie interne. La diminution de l'énergie interne se traduit par une chute de température.
Mini-Cours
Pour une transformation adiabatique et réversible d'un gaz parfait, les états initial et final sont reliés par les lois de Laplace. Celle qui relie la température et le volume est la plus utile ici : \(T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}\). L'indice \(\gamma\) est le rapport des capacités thermiques \(C_P/C_V\). Pour un gaz parfait monoatomique, \(\gamma=5/3\). Comme \(Q=0\), le premier principe devient \(\Delta U = W\).
Remarque Pédagogique
Cette étape est cruciale car elle permet au fluide de refroidir pour atteindre la température de la source froide, sans perdre de chaleur inutilement. C'est l'un des secrets de l'efficacité du cycle de Carnot. La clé du calcul est de choisir la bonne loi de Laplace pour trouver la variable manquante (ici, \(V_C\)).
Normes
Les conventions de signe de l'UICPA s'appliquent toujours.
Formule(s)
Loi de Laplace (forme T-V)
Travail d'une transformation adiabatique
Hypothèses
- Gaz parfait.
- Transformation adiabatique réversible (pas de création d'entropie interne).
- Le système est parfaitement isolé thermiquement.
Donnée(s)
Les données proviennent de l'état final de la transformation précédente (état B) et des conditions de la source froide spécifiées dans l'énoncé.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température initiale | \(T_B\) | 600 | K |
| Volume initial | \(V_B\) | 20 | L |
| Température finale | \(T_C\) | 300 | K |
| Indice adiabatique | \(\gamma\) | 5/3 | - |
| Capacité thermique | \(C_{V,m}\) | \(\frac{3}{2}R \approx 12.47\) | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
Astuces
L'exposant dans la loi de Laplace est \(\frac{1}{\gamma-1}\). Pour un gaz monoatomique, \(\gamma-1 = 5/3 - 1 = 2/3\). L'exposant devient donc \(1/(2/3) = 3/2 = 1.5\). Mémoriser cette valeur peut accélérer les calculs.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma de la détente adiabatique (B → C)
Calcul(s)
Calcul du volume \(V_C\)
Calcul du travail \(W_{BC}\)
Par définition, la chaleur échangée est nulle : \(Q_{BC} = 0\).
Schéma (Après les calculs)
Bilan énergétique de l'étape B → C
Réflexions
Comme pour la première étape, \(W_{BC}<0\) : le gaz continue de fournir du travail en se détendant. Cette énergie provient bien de son énergie interne, car sa température a diminué de moitié. Sur le diagramme (P,V), une courbe adiabatique est plus "pentue" qu'une isotherme.
Points de vigilance
- Ne pas confondre les différentes formes des lois de Laplace (\(PV^\gamma=\text{cste}\) vs \(TV^{\gamma-1}=\text{cste}\)). Utilisez celle qui relie les variables connues et cherchées.
- Attention à l'ordre des températures dans le calcul de \(\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}\). Une erreur ici inverserait le signe du travail.
Points à retenir
Synthèse de la détente adiabatique (gaz parfait) :
- Aucun échange de chaleur (\(Q=0\)).
- Le travail fourni est pris sur l'énergie interne : \(W = \Delta U < 0\).
- La température et la pression chutent.
Le saviez-vous ?
Les processus adiabatiques rapides sont courants. Le son se propage dans l'air sous forme de petites compressions et détentes si rapides qu'elles n'ont pas le temps d'échanger de la chaleur. C'est pourquoi la vitesse du son dépend de l'indice adiabatique \(\gamma\) de l'air.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
En utilisant la loi des gaz parfaits (\(PV=nRT\)), quelle était la pression \(P_B\) au début de cette détente ? (Donnez la réponse en Pascals, arrondie à l'entier).
Question 3 : Compression isotherme (C → D)
Principe
Cette étape est la symétrique de la première, mais à la température de la source froide (\(T_{\text{froide}}=300\text{ K}\)). Le gaz est comprimé, ce qui signifie que l'extérieur fournit du travail au système. Pour que la température reste constante, le gaz doit évacuer la chaleur générée par cette compression vers la source froide. L'énergie interne reste constante.
Mini-Cours
Les principes sont identiques à la détente isotherme : \(\Delta U = 0\) et \(Q = -W\). La différence réside dans les signes. Une compression implique \(V_{\text{final}} < V_{\text{initial}}\), donc \(\ln(V_f/V_i) < 0\). Le travail \(W = -nRT \ln(V_f/V_i)\) sera donc positif (travail reçu par le gaz) et la chaleur \(Q\) sera négative (chaleur cédée par le gaz).
Remarque Pédagogique
Cette phase est essentielle : c'est ici que le moteur rejette la chaleur "inutile" qui ne peut être convertie en travail, conformément au second principe de la thermodynamique. Sans cette étape, il serait impossible de fermer le cycle et de revenir à l'état initial.
Normes
La convention de signe de l'UICPA reste notre référence.
Formule(s)
Pour trouver le volume \(V_D\), on peut utiliser la loi de Laplace pour la transformation D → A :
Ensuite, pour le travail et la chaleur :
Hypothèses
- Gaz parfait.
- Transformation isotherme réversible.
- Contact thermique parfait avec la source froide.
Donnée(s)
Les données sont issues du résultat de la question 2 (volume \(V_C\)) et des informations de l'énoncé (températures des sources, volume \(V_A\)).
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température de l'isotherme | \(T_{\text{froide}} = T_D\) | 300 | K |
| Volume initial | \(V_C\) | ~56.57 | L |
| Volume de référence | \(V_A\) | 10 | L |
| Température de référence | \(T_A\) | 600 | K |
| Indice adiabatique | \(\gamma\) | 5/3 | - |
Astuces
Pour un cycle de Carnot, il existe une relation simple entre les volumes des quatre sommets : \(\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}\). Connaissant \(V_A, V_B, V_C\), on peut trouver \(V_D\) très rapidement : \(V_D = V_C \times (V_A / V_B) = 56.57 \times (10/20) = 28.285\) L. C'est un excellent moyen de vérifier le calcul par la loi de Laplace.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma de la compression isotherme (C → D)
Calcul(s)
Calcul du volume \(V_D\)
Calcul du travail \(W_{CD}\)
Calcul de la chaleur \(Q_{CD}\)
Schéma (Après les calculs)
Bilan énergétique de l'étape C → D
Réflexions
Le travail est positif, ce qui confirme que de l'énergie a été fournie au gaz pour le comprimer. La chaleur est négative, confirmant que le gaz a rejeté de l'énergie thermique vers la source froide. Cette chaleur rejetée est inévitable et représente une "perte" du point de vue de l'efficacité.
Points de vigilance
- Le principal piège est le calcul de \(V_D\). Les deux méthodes (loi de Laplace sur D→A ou rapport des volumes) doivent donner le même résultat.
- Attention au signe du logarithme : \(\ln(x) < 0\) si \(x < 1\).
Points à retenir
Synthèse de la compression isotherme (gaz parfait) :
- La température est constante (\(\Delta U=0\)).
- Le travail reçu par le gaz est intégralement évacué sous forme de chaleur : \(W = -Q > 0\).
- Cette étape est nécessaire pour "rejeter" la chaleur non convertible en travail.
Le saviez-vous ?
Le condenseur à l'arrière d'un réfrigérateur est un exemple concret de "source froide". Le fluide frigorigène est comprimé (devenant chaud) puis passe dans le serpentin du condenseur pour céder sa chaleur à l'air de la pièce, avant de pouvoir se détendre et produire du froid à l'intérieur.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si la source froide était à 250 K au lieu de 300 K, quelle serait la chaleur \(Q_{CD}\) cédée (en supposant les mêmes volumes C et D) ? (Réponse en J, arrondie à l'entier).
Question 4 : Compression adiabatique (D → A)
Principe
C'est la dernière étape qui ferme le cycle. Le gaz est comprimé sans échange de chaleur. Tout le travail fourni par l'extérieur sert donc à augmenter l'énergie interne du gaz, ce qui se traduit par une augmentation de sa température, le ramenant de \(T_{\text{froide}}\) à \(T_{\text{chaude}}\) et à son état initial A.
Mini-Cours
Les principes sont les mêmes que pour la détente adiabatique (question 2) : \(Q=0\) et \(W=\Delta U\). La seule différence est que cette fois, le gaz est comprimé. Le travail sera donc positif (reçu par le système), et la variation d'énergie interne sera positive, entraînant une augmentation de la température.
Remarque Pédagogique
Cette étape consomme du travail pour "re-préparer" le gaz pour la prochaine phase de puissance (détente isotherme A→B). Notez la symétrie parfaite avec la détente adiabatique B→C. Dans un cycle de Carnot, les travaux des deux transformations adiabatiques se compensent exactement.
Normes
La convention de signe de l'UICPA s'applique toujours.
Formule(s)
Travail d'une transformation adiabatique
Chaleur
Hypothèses
- Gaz parfait.
- Transformation adiabatique réversible.
- Système parfaitement isolé thermiquement.
Donnée(s)
Les données correspondent à l'état final de la question 3 (état D) et à l'état initial du cycle (état A), dont les caractéristiques sont définies dans l'énoncé.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température initiale | \(T_D\) | 300 | K |
| Température finale | \(T_A\) | 600 | K |
| Capacité thermique | \(C_{V,m}\) | \(\frac{3}{2}R \approx 12.47\) | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
Astuces
Comme \(\Delta T_{DA} = (600 - 300) = 300\) K et que \(\Delta T_{BC} = (300 - 600) = -300\) K, on peut voir immédiatement que \(W_{DA} = -W_{BC}\) sans même refaire le calcul. C'est une caractéristique de la symétrie du cycle de Carnot.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma de la compression adiabatique (D → A)
Calcul(s)
Calcul du travail \(W_{DA}\)
La chaleur échangée est nulle : \(Q_{DA} = 0\).
Schéma (Après les calculs)
Bilan énergétique de l'étape D → A
Réflexions
Le travail est positif, ce qui correspond bien à une compression. On vérifie bien que \(W_{DA} \approx -W_{BC}\). Le cycle est maintenant complet, le système est revenu à l'état A, prêt à recommencer.
Points de vigilance
La principale source d'erreur est de se tromper dans le \(\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}\). Ici, c'est bien \(T_A - T_D\). Une inversion mènerait à un signe de travail incorrect.
Points à retenir
Synthèse de la compression adiabatique (gaz parfait) :
- Aucun échange de chaleur (\(Q=0\)).
- Le travail reçu augmente l'énergie interne : \(W = \Delta U > 0\).
- La température et la pression augmentent.
Le saviez-vous ?
Le principe de la compression adiabatique est utilisé dans les moteurs Diesel. L'air est comprimé si fortement et si rapidement que sa température s'élève à plus de 500°C, ce qui est suffisant pour enflammer spontanément le carburant injecté, sans avoir besoin de bougie d'allumage.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Vérifiez que le point A est bien l'état final. En utilisant la loi de Laplace sur D→A (\(T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}\)), montrez que le volume final est bien \(V_A = 10 \text{ L}\). Calculez \(V_D \left(\frac{T_D}{T_A}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\).
Question 5 : Bilan du cycle et rendement
Principe
Le bilan énergétique sur un cycle complet permet de quantifier la performance du moteur. Le travail total (ou travail net) est l'énergie mécanique réellement produite, et le rendement mesure l'efficacité avec laquelle la chaleur consommée a été convertie en ce travail utile.
Mini-Cours
Le travail net du cycle est la somme des travaux de chaque étape : \(W_{\text{cycle}} = \sum W_i\). Puisque \(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\), on a aussi \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}} = -(Q_{\text{chaud}} + Q_{\text{froid}})\). Le rendement \(\eta\) est défini comme le rapport de l'énergie utile sur l'énergie coûteuse : \(\eta = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{chaud}}}\). Le théorème de Carnot énonce que ce rendement est au maximum égal à \(\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_{\text{froide}}/T_{\text{chaude}}\), cette limite étant atteinte uniquement pour un cycle réversible.
Remarque Pédagogique
Comparer le rendement que vous calculez à partir des énergies (\(W\) et \(Q\)) avec la formule théorique de Carnot (\(1-T_F/T_C\)) est un excellent moyen de vérifier l'ensemble de vos calculs. Si les deux ne correspondent pas, une erreur s'est glissée quelque part !
Normes
Le rendement est une grandeur sans dimension, comprise entre 0 et 1. On l'exprime souvent en pourcentage (en multipliant par 100).
Formule(s)
Travail net du cycle
Rendement calculé
Rendement théorique de Carnot
Hypothèses
- Le cycle est analysé dans son ensemble.
- Les transferts de chaleur ne se produisent qu'avec les sources chaude et froide.
Donnée(s)
On rassemble ici tous les résultats des calculs de travail et de chaleur effectués dans les questions 1 à 4.
| Paramètre | Symbole | Valeur approximative | Unité |
|---|---|---|---|
| Travail (A→B) | \(W_{AB}\) | -3458 | J |
| Travail (B→C) | \(W_{BC}\) | -3741 | J |
| Travail (C→D) | \(W_{CD}\) | 1729 | J |
| Travail (D→A) | \(W_{DA}\) | 3741 | J |
| Chaleur absorbée | \(Q_{\text{chaud}}\) | 3458 | J |
Astuces
Remarquez que \(W_{BC} + W_{DA} = 0\). Le travail net est donc simplement la somme des travaux isothermes : \(W_{\text{cycle}} = W_{AB} + W_{CD}\). De même, \(Q_{\text{cycle}} = Q_{AB} + Q_{CD}\). Cela simplifie grandement le bilan.
Schéma (Avant les calculs)
Représentation schématique d'un moteur thermique
Calcul(s)
Calcul du travail total du cycle
Calcul du rendement
Calcul du rendement théorique de Carnot
Schéma (Après les calculs)
Travail Net du Cycle
Le travail utile \(W_{\text{utile}} = -W_{\text{cycle}}\) correspond à l'aire graphique enfermée par le cycle dans le diagramme (P,V).
Réflexions
L'égalité parfaite entre le rendement calculé et le rendement théorique de Carnot est la confirmation que nos calculs sont cohérents. Elle illustre le fait que le cycle de Carnot, parce qu'il est réversible et n'échange de la chaleur qu'aux températures extrêmes, atteint la meilleure efficacité possible. Tout moteur réel, à cause des frottements et des transferts de chaleur non idéaux (irréversibilités), aura un rendement inférieur.
Points de vigilance
- La plus grande source d'erreur est la gestion des signes. \(W_{\text{cycle}}\) est le travail total reçu par le gaz. Le travail utile produit par le moteur est son opposé, \(-W_{\text{cycle}}\). Le rendement doit être un nombre positif.
- \(Q_{\text{chaud}}\) est la somme de toutes les chaleurs positives reçues (ici, seulement \(Q_{AB}\)).
Points à retenir
Synthèse du bilan d'un cycle moteur :
- \(\eta = \frac{\text{Ce qu'on gagne}}{\text{Ce qu'on paie}} = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{chaud}}}\).
- Pour tout moteur réel, \(\eta < \eta_{\text{Carnot}}\).
- Pour un moteur de Carnot idéal, \(\eta = \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{froide}}}{T_{\text{chaude}}}\).
Le saviez-vous ?
Pour augmenter le rendement d'une centrale thermique, les ingénieurs cherchent à augmenter \(T_{\text{chaude}}\) au maximum (en utilisant des matériaux plus résistants) et à diminuer \(T_{\text{froide}}\) au maximum. C'est pourquoi les centrales sont souvent construites près de rivières ou de la mer, qui agissent comme une "source froide" efficace pour évacuer la chaleur.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Un moteur réel fonctionne entre les mêmes sources (\(T_{\text{chaude}}=600\text{ K}, T_{\text{froide}}=300\text{ K}\)) et absorbe la même chaleur \(Q_{\text{chaud}}=3458 \text{ J}\), mais ne produit qu'un travail utile de 1000 J. Quel est son rendement réel ?
Outil Interactif : Simulateur de Rendement
Utilisez les curseurs pour faire varier les températures des sources chaude et froide et observez leur impact direct sur le rendement maximal théorique d'un moteur thermique (le rendement de Carnot).
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. D'après le premier principe de la thermodynamique appliqué à un cycle, quelle affirmation est correcte ?
2. Que vaut la quantité de chaleur échangée lors d'une transformation adiabatique ?
3. Le rendement d'un moteur de Carnot idéal ne dépend que...
4. Lors de la détente isotherme d'un gaz parfait...
5. Le rendement de Carnot \(1 - T_{\text{froide}}/T_{\text{chaude}}\) représente...
Glossaire
- Cycle de Carnot
- Cycle thermodynamique théorique réversible composé de deux transformations isothermes et deux transformations adiabatiques. Il représente le cycle le plus efficace possible pour un moteur fonctionnant entre deux températures données.
- Machine thermique ditherme
- Système qui subit un cycle thermodynamique en échangeant de la chaleur avec deux sources de chaleur à des températures différentes (\(T_{\text{chaude}}\) et \(T_{\text{froide}}\)), produisant ou consommant du travail.
- Rendement thermique (\(\eta\))
- Pour un moteur, c'est le rapport entre l'énergie mécanique utile produite (le travail) et l'énergie thermique fournie par la source chaude. C'est une mesure de l'efficacité de la conversion de chaleur en travail.
- Transformation adiabatique
- Transformation réalisée sans aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur (\(Q=0\)).
- Transformation isotherme
- Transformation au cours de laquelle la température du système reste constante (\(T=\text{cste}\)).
D’autres exercices de Themodynamique:
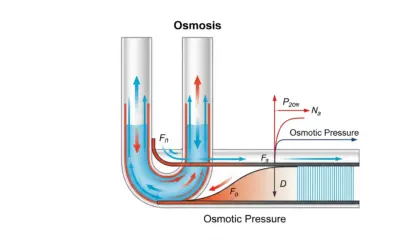
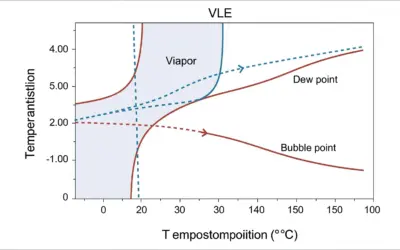
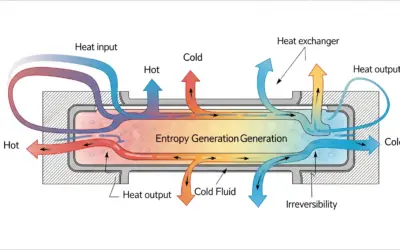
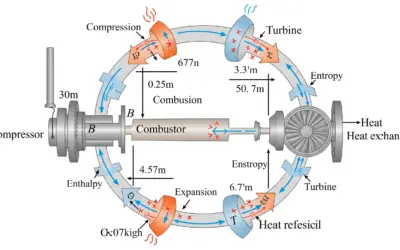
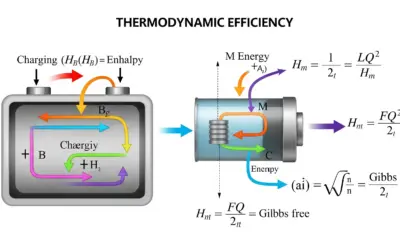
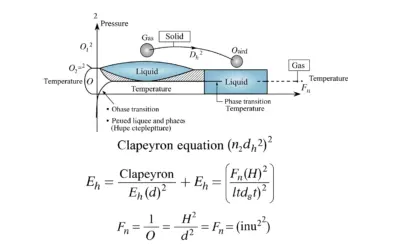
0 commentaires