Détente de Joule-Gay-Lussac
Contexte : La détente de Joule-Gay-LussacExpansion d'un gaz dans le vide, se produisant dans un système isolé thermiquement, sans échange de travail avec l'extérieur..
Cette expérience historique est fondamentale en thermodynamique. Elle consiste à laisser un gaz, initialement contenu dans un compartiment, se détendre dans un second compartiment préalablement vidé. L'ensemble des deux compartiments est thermiquement isolé du reste de l'univers. L'objectif est d'étudier comment l'énergie interneSomme des énergies cinétiques et potentielles de toutes les particules constituant un système. Pour un gaz parfait, elle ne dépend que de la température. d'un gaz varie en fonction de son volume à température constante.
Remarque Pédagogique : Cet exercice permet d'appliquer concrètement le premier principe de la thermodynamique à une transformation irréversible. Il met en lumière une propriété essentielle des gaz parfaits et introduit la notion de création d'entropie.
Objectifs Pédagogiques
- Appliquer le premier principe de la thermodynamique à un système fermé.
- Analyser une transformation adiabatique et sans échange de travail.
- Déterminer la variation de température d'un gaz parfait lors de cette détente.
- Calculer la variation d'entropie d'une transformation irréversible.
Données de l'étude
Conditions Initiales et Finales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gaz étudié | Hélium (He), supposé parfait et monoatomique |
| Quantité de matière, \(n\) | 1,0 \(\text{mol}\) |
| Température initiale, \(T_1\) | 298 \(\text{K}\) |
| Volume initial, \(V_1\) | 10 \(\text{L}\) |
| Volume final, \(V_2\) | 20 \(\text{L}\) |
Dispositif Expérimental de la Détente
| Nom du Paramètre | Description ou Formule | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | \(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\) |
| Capacité thermique molaire à volume constant | \(C_{v,m}\) (gaz monoatomique) | \(\frac{3}{2}R\) | \(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\) |
Questions à traiter
- Justifier la nature de cette transformation : est-elle adiabatique ? Y a-t-il un échange de travail ?
- En appliquant le premier principe de la thermodynamique, déterminer la variation d'énergie interne \(\Delta U\) du gaz.
- En utilisant la première loi de Joule pour les gaz parfaits, déduire la variation de température \(\Delta T\) et la température finale \(T_2\) du gaz.
- Calculer la variation d'entropie \(\Delta S\) du gaz au cours de cette détente.
- La transformation est-elle réversible ou irréversible ? Justifier à l'aide du second principe.
Les bases sur la détente de Joule-Gay-Lussac
Pour résoudre cet exercice, deux concepts fondamentaux de la thermodynamique sont nécessaires : le premier principe et la définition de l'énergie interne pour un gaz parfait.
1. Premier Principe de la Thermodynamique
Ce principe est une loi de conservation de l'énergie. Pour un système fermé, la variation de son énergie interne \(\Delta U\) est égale à la somme de la chaleur \(Q\) et du travail \(W\) échangés avec l'extérieur.
\[ \Delta U = Q + W \]
2. Énergie Interne d'un Gaz Parfait (1ère loi de Joule)
Pour un gaz parfaitModèle théorique d'un gaz où les particules sont supposées ponctuelles et n'interagissent pas entre elles, sauf par des collisions élastiques., l'énergie interne ne dépend que de sa température. Toute variation d'énergie interne est donc directement liée à une variation de température via la capacité thermique molaire à volume constant \(C_{v,m}\).
\[ \Delta U = n \cdot C_{v,m} \cdot \Delta T \]
Correction : Détente de Joule-Gay-Lussac
Question 1 : Nature de la transformation
Principe
On analyse les interactions entre le système (le gaz) et l'extérieur. L'énoncé nous donne des indices cruciaux sur l'isolation thermique et la nature de l'expansion.
Mini-Cours
Une transformation est dite adiabatique si le système n'échange pas de chaleur avec l'extérieur (\(Q=0\)). Le travail des forces de pression (\(W\)) est l'énergie échangée due à une variation de volume du système contre une pression extérieure \(P_{\text{ext}}\). Il est nul si le volume ne change pas, ou si la pression extérieure est nulle.
Schéma
Comparaison : Travail nul vs Travail non-nul
Réflexions
- Échange de chaleur (Q) : L'énoncé précise que l'enceinte globale est "adiabatique". Cela signifie par définition qu'il n'y a aucun transfert de chaleur entre le système et l'extérieur. Donc, \(Q = 0\).
- Échange de travail (W) : Le travail des forces de pression est défini par \(W = -\int P_{\text{ext}} \text{d}V\). Ici, le gaz se détend dans un compartiment vide, où la pression extérieure qui s'oppose à l'expansion est nulle (\(P_{\text{ext}} = 0\)). Par conséquent, le travail échangé avec l'extérieur est nul. Donc, \(W = 0\).
Points de vigilance
Ne pas confondre adiabatique (\(Q=0\)) et isotherme (\(\Delta T=0\)). Une transformation peut être l'un, l'autre, les deux ou aucun des deux. Ici, on établit que \(Q=0\), la question de la température viendra plus tard. De plus, le travail serait non-nul si la détente se faisait contre un piston mobile, même avec \(Q=0\).
Points à retenir
- Paroi adiabatique \(\Rightarrow\) \(Q=0\).
- Détente dans le vide (\(P_{\text{ext}}=0\)) \(\Rightarrow\) \(W=0\).
Résultat Final
Question 2 : Variation d'énergie interne \(\Delta U\)
Principe (le concept physique)
Le premier principe de la thermodynamique est le principe de conservation de l'énergie appliqué à un système. Il stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée. La variation de l'énergie interne d'un système est donc égale à la somme des énergies qu'il échange avec l'extérieur (sous forme de chaleur et de travail).
Mini-Cours (approfondissement théorique)
L'énergie interne \(U\) est une fonction d'état qui représente toute l'énergie contenue dans un système (énergie cinétique d'agitation des molécules, énergie potentielle d'interaction...). Sa variation \(\Delta U\) ne dépend que de l'état initial et de l'état final. La chaleur \(Q\) et le travail \(W\) ne sont pas des fonctions d'état ; ce sont des modes de transfert d'énergie. Un \(Q > 0\) signifie que le système reçoit de la chaleur, et un \(W > 0\) signifie que le système reçoit du travail.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
Face à un problème de thermodynamique, le premier réflexe doit toujours être d'écrire le premier principe \(\Delta U = Q + W\). Ensuite, qualifiez la transformation pour voir si l'un des termes (\(Q\) ou \(W\)) peut être annulé. C'est la clé pour simplifier 90% des exercices.
Normes (la référence réglementaire)
Il ne s'agit pas d'une norme d'ingénierie, mais d'une loi fondamentale de la physique, universellement acceptée et validée par d'innombrables expériences depuis le XIXe siècle. C'est l'un des piliers de toute la science physique.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Premier principe de la thermodynamique
Hypothèses (le cadre du calcul)
Nous appliquons le premier principe au système fermé constitué par le gaz. Les hypothèses, déjà établies à la question 1, sont cruciales ici.
- Le système est thermiquement isolé : transformation adiabatique.
- La détente se fait contre une pression extérieure nulle.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
Les données utilisées ici sont les conclusions tirées de l'analyse de la nature de la transformation à la question 1.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Chaleur échangée | \(Q\) | 0 | \(\text{J}\) |
| Travail échangé | \(W\) | 0 | \(\text{J}\) |
Astuces (Pour aller plus vite)
Pour toute transformation se déroulant dans un système isolé (qui n'échange ni chaleur ni travail avec l'extérieur), la variation d'énergie interne est toujours nulle. C'est une conséquence directe de la conservation de l'énergie.
Schéma (Avant les calculs)
Bilan Énergétique du Système
Calcul(s) (l'application numérique)
Application du premier principe
Schéma (Après les calculs)
Conservation de l'Énergie Interne
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Un \(\Delta U = 0\) signifie que l'énergie totale du gaz est conservée. Bien que le gaz occupe un volume plus grand, l'énergie cinétique totale de ses molécules n'a pas changé. C'est un résultat contre-intuitif car on pourrait penser que la détente "consomme" de l'énergie, mais comme aucune force extérieure ne s'y oppose, aucun travail n'est fourni.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
L'erreur classique est de confondre \(\Delta U = 0\) et \(\Delta T = 0\). Si \(\Delta U = 0\) implique bien \(\Delta T = 0\) pour un gaz parfait (voir question 3), ce n'est pas vrai pour un gaz réel, dont l'énergie interne dépend aussi du volume (forces intermoléculaires).
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- Le premier principe est \(\Delta U = Q + W\).
- Une détente dans le vide est caractérisée par \(Q=0\) et \(W=0\).
- Par conséquent, pour une détente de Joule-Gay-Lussac, la variation d'énergie interne du gaz est toujours nulle.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
James Prescott Joule a utilisé une expérience similaire vers 1845 pour tenter de démontrer que l'énergie interne d'un gaz ne dépendait que de la température. À l'époque, ses thermomètres n'étaient pas assez précis pour détecter la très faible variation de température qui se produit pour les gaz réels, le menant à postuler sa première loi, qui est une approximation exacte pour les gaz parfaits.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant par rapport a la question)
Que vaudrait \(\Delta U\) si, pendant la même détente, le système recevait 50 J de chaleur d'une résistance chauffante ?
Question 3 : Variation de température \(\Delta T\)
Principe (le concept physique)
La première loi de Joule stipule que l'énergie interne d'un gaz parfait est une fonction exclusive de sa température. Cela signifie que si l'énergie interne ne varie pas, la température ne varie pas non plus. Cette loi découle du modèle du gaz parfait où l'on néglige les interactions entre les molécules.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
Pour un gaz parfait, l'énergie interne représente uniquement l'énergie cinétique d'agitation de ses molécules. La température est une mesure macroscopique de cette agitation moyenne. La relation différentielle est \(dU = n C_{v,m} dT\). En intégrant entre un état 1 et un état 2, on obtient la formule utilisée. Pour un gaz réel, il faudrait ajouter un terme dépendant du volume : \(dU = n C_{v,m} dT + \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P\right]dV\).
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
L'enchaînement logique est crucial : le 1er principe nous donne \(\Delta U\), et la loi de Joule nous permet de "traduire" cette variation d'énergie en variation de température. Retenez bien : Gaz parfait + \(\Delta U = 0 \Rightarrow \Delta T = 0\).
Normes (la référence réglementaire)
La première loi de Joule n'est pas une norme mais un modèle physique fondamental. C'est une définition du comportement du gaz parfait, qui sert de référence pour l'étude des gaz réels.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Première loi de Joule pour un gaz parfait
Hypothèses (le cadre du calcul)
L'hypothèse centrale de cette question est que l'hélium se comporte comme un gaz parfait. C'est une excellente approximation dans ces conditions.
- Le gaz est parfait.
- La capacité thermique molaire \(C_{v,m}\) est constante sur la plage de température considérée (ce qui est vrai ici car la température ne varie pas).
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
On utilise le résultat de la question 2 (\(\Delta U = 0\)) ainsi que les données de l'énoncé.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Variation d'énergie interne | \(\Delta U\) | 0 | \(\text{J}\) |
| Quantité de matière | \(n\) | 1.0 | \(\text{mol}\) |
| Capacité thermique | \(C_{v,m}\) | \(\frac{3}{2}R \approx 12.47\) | \(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\) |
Astuces (Pour aller plus vite)
Dès que vous lisez "détente de Joule-Gay-Lussac" et "gaz parfait" dans un énoncé, vous pouvez immédiatement conclure que la transformation est isotherme (\(\Delta T = 0\)) sans même passer par le calcul de \(\Delta U\). C'est le résultat à connaître par cœur.
Schéma (Avant les calculs)
Interrogation sur la Température
Calcul(s) (l'application numérique)
Isolation de la variation de température
Application numérique pour \(\Delta T\)
Calcul de la température finale \(T_2\)
Schéma (Après les calculs)
Diagramme de Clapeyron (P,V)
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Ce résultat confirme notre intuition : sans travail externe et sans forces internes à vaincre (modèle du gaz parfait), l'énergie cinétique des molécules n'a aucune raison de changer. L'agitation thermique, et donc la température, reste constante.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Ne pas appliquer ce résultat à un gaz réel sans précaution. Pour un gaz réel, les forces d'attraction (forces de van der Waals) existent. Lors de la détente, les molécules s'éloignent, ce qui nécessite de "lutter" contre ces forces. Le système puise dans son énergie interne pour fournir ce travail interne, ce qui provoque un léger refroidissement (effet Joule-Thomson).
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- Loi de Joule : l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de T.
- Formule : \(\Delta U = n C_{v,m} \Delta T\).
- Conséquence : la détente de Joule-Gay-Lussac d'un gaz parfait est isotherme.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Le léger refroidissement des gaz réels lors d'une détente similaire est un principe clé de la réfrigération et de la liquéfaction des gaz. C'est en utilisant des détentes successives (procédé Linde) que l'on peut refroidir l'air au point de le liquéfier pour séparer l'oxygène et l'azote.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant par rapport a la question)
Si l'énergie interne du gaz avait diminué de 100 J, quelle aurait été la température finale \(T_2\) ?
Question 4 : Variation d'entropie \(\Delta S\)
Principe (le concept physique)
L'entropie \(S\) est une mesure du désordre d'un système. Le second principe de la thermodynamique nous dit que pour une transformation spontanée dans un système isolé, ce désordre ne peut qu'augmenter. Puisque l'entropie est une fonction d'état, on peut calculer sa variation entre deux points en imaginant n'importe quel chemin réversible qui les relie, même si le chemin réel est irréversible.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
La définition de base de la variation d'entropie est \(dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}\). Pour un gaz parfait, en combinant le premier principe (\(dU = \delta Q + \delta W\)) et la loi de Joule (\(dU = n C_{v,m} dT\)) pour un chemin réversible (\(\delta W_{\text{rev}} = -P dV\)), on obtient \(\delta Q_{\text{rev}} = n C_{v,m} dT + P dV\). En divisant par T et en utilisant \(P/T = nR/V\), on trouve \(dS = n C_{v,m} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}\), dont l'intégration donne la formule utilisée.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
Ne tombez pas dans le piège ! On ne peut PAS utiliser \( \Delta S = Q/T \) ici, car cette formule n'est valable que pour une transformation réversible à température constante. Ici, \(Q=0\), ce qui donnerait \(\Delta S = 0\), un résultat faux. La transformation est irréversible, il faut donc passer par la formule générale impliquant les variables d'état (T et V, ou T et P).
Formule(s) (l'outil mathématique)
Variation d'entropie d'un gaz parfait
Hypothèses (le cadre du calcul)
On continue de supposer que l'hélium est un gaz parfait. C'est cette hypothèse qui nous permet d'utiliser la formule ci-dessus.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
On rassemble les données de l'énoncé et les résultats concernant la température finale trouvés à la question 3.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Quantité de matière | \(n\) | 1.0 | \(\text{mol}\) |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | \(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\) |
| Température initiale | \(T_1\) | 298 | \(\text{K}\) |
| Température finale | \(T_2\) | 298 | \(\text{K}\) |
| Volume initial | \(V_1\) | 10 | \(\text{L}\) |
| Volume final | \(V_2\) | 20 | \(\text{L}\) |
Astuces (Pour aller plus vite)
Puisque la détente de Joule-Gay-Lussac d'un gaz parfait est isotherme, le premier terme de la formule de \(\Delta S\) (celui avec \(\ln(T_2/T_1)\)) est toujours nul. La variation d'entropie ne dépend que de l'augmentation du volume.
Schéma (Avant les calculs)
Visualisation de l'augmentation du désordre
Calcul(s) (l'application numérique)
On part de la formule générale de la variation d'entropie. Comme nous avons démontré à la question 3 que la transformation est isotherme (\(T_2 = T_1\)), le terme contenant le logarithme des températures s'annule, car \(\ln(1)=0\). La formule se simplifie donc grandement.
Simplification de la formule
Il ne reste plus qu'à remplacer les variables par leurs valeurs numériques pour trouver le résultat final. On utilise le rapport des volumes \(\frac{20 \text{ L}}{10 \text{ L}} = 2\).
Application numérique
Schéma (Après les calculs)
Augmentation de l'Entropie
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Le résultat est positif, ce qui signifie que le désordre du système a augmenté. C'est tout à fait logique : en ayant plus d'espace disponible, les molécules de gaz ont beaucoup plus de positions et de vitesses possibles qu'à l'état initial. L'expansion spontanée d'un gaz est l'exemple même d'un phénomène gouverné par l'augmentation de l'entropie.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Attention aux unités ! Les volumes \(V_1\) et \(V_2\) peuvent être en litres (L) ou en m³, tant que l'on utilise la même unité pour les deux, car c'est leur rapport qui compte. La constante R doit être en \(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\) pour obtenir une entropie en \(\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\).
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- L'entropie est une fonction d'état, son calcul ne dépend pas du chemin suivi.
- Pour un gaz parfait, la formule générale de \(\Delta S\) dépend de \(T\) et \(V\).
- Pour une détente isotherme (\(T_1=T_2\)), la formule se réduit à \(\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)\).
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Le concept d'entropie a été introduit par Rudolf Clausius en 1865. Ludwig Boltzmann lui a donné plus tard une interprétation statistique, la reliant au nombre de micro-états \(\Omega\) accessibles à un système via la célèbre formule gravée sur sa tombe : \(S = k_B \ln \Omega\).
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant par rapport a la question)
Calculez \(\Delta S\) si le volume final était de 40 L au lieu de 20 L (quadruplement du volume).
Question 5 : Réversibilité de la transformation
Principe
Le second principe de la thermodynamique stipule que pour un système isolé, l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter ou rester constante. Une augmentation stricte signe une transformation irréversible. Une transformation réversible est une idéalisation qui se déroulerait de manière quasi-statique, permettant au système de revenir à son état initial en repassant par les mêmes états intermédiaires.
Mini-Cours
Le bilan d'entropie pour une transformation s'écrit : \(\Delta S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{système}} + \Delta S_{\text{extérieur}} = S_{\text{créée}}\). \(\Delta S_{\text{extérieur}}\) est l'entropie échangée, calculée par \(-Q/T_{\text{ext}}\). \(S_{\text{créée}}\) est l'entropie créée par les irréversibilités.
- Si \(S_{\text{créée}} > 0\), la transformation est irréversible (cas réel).
- Si \(S_{\text{créée}} = 0\), la transformation est réversible (cas idéal).
Schéma
Chemin Réversible vs Irréversible
Réflexions
- Notre système est le gaz. Sa variation d'entropie est \(\Delta S_{\text{système}} = \Delta S \approx +5.76 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\).
- L'extérieur est tout ce qui n'est pas le gaz. Comme la transformation est adiabatique (\(Q=0\)), il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et l'extérieur. La variation d'entropie de l'extérieur est donc nulle : \(\Delta S_{\text{extérieur}} = 0\).
- On peut donc calculer la variation d'entropie de l'univers (qui est notre système isolé) :
\(\Delta S_{\text{univers}} = 5.76 + 0 = 5.76 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\).
Points de vigilance
Une erreur fréquente est de penser que si \(Q=0\), alors \(\Delta S\) doit être nul. C'est faux. L'entropie échangée avec l'extérieur est nulle, mais l'entropie créée à l'intérieur du système à cause du caractère brutal et non-contrôlé de la détente est, elle, bien réelle et positive.
Points à retenir
- Le critère de réversibilité se base sur l'entropie créée : \(\Delta S_{\text{univers}}\).
- \(\Delta S_{\text{univers}} > 0 \Rightarrow\) Irréversible.
- \(\Delta S_{\text{univers}} = 0 \Rightarrow\) Réversible.
- Une détente spontanée dans le vide est fondamentalement irréversible.
Résultat Final
Outil Interactif : Création d'Entropie
Utilisez ce simulateur pour voir comment la quantité de gaz (en moles) et le rapport de détente (\(V_2/V_1\)) influencent la variation d'entropie, qui est une mesure du désordre créé.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Dans une détente de Joule-Gay-Lussac pour un gaz parfait, le travail \(W\) échangé est :
2. La variation d'énergie interne \(\Delta U\) du gaz parfait lors de cette détente est :
3. Pour un gaz parfait, comment la température finale \(T_2\) se compare-t-elle à la température initiale \(T_1\) ?
4. La détente de Joule-Gay-Lussac est une transformation :
5. Que se passerait-il si on réalisait la même expérience avec un gaz réel (comme le CO₂) au lieu d'un gaz parfait ?
Glossaire
- Détente de Joule-Gay-Lussac
- Une transformation thermodynamique où un gaz se détend dans un volume vide, l'ensemble étant thermiquement isolé de l'extérieur (\(Q=0\)) et sans production de travail (\(W=0\)).
- Transformation Adiabatique
- Un processus qui se déroule sans échange de chaleur avec le milieu extérieur (\(Q=0\)).
- Énergie Interne (U)
- Une fonction d'état qui représente l'énergie totale contenue dans un système thermodynamique. Pour un gaz parfait, elle ne dépend que de la température.
- Entropie (S)
- Une fonction d'état qui mesure le degré de désordre d'un système. L'entropie de l'univers augmente pour toute transformation irréversible (second principe).
D'autres exercices de thermodynamique:
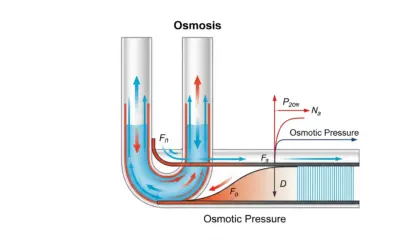
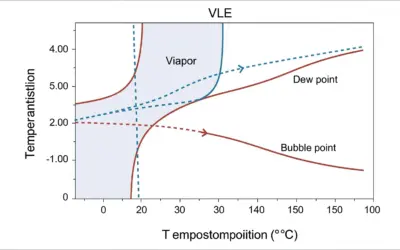
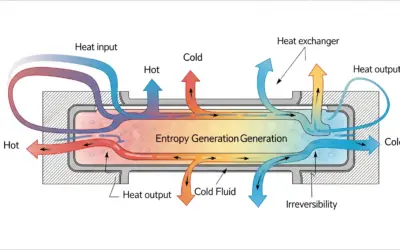
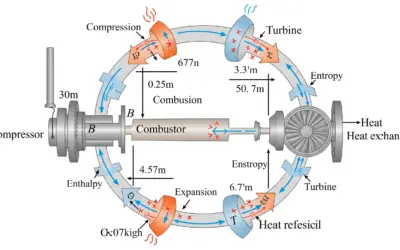
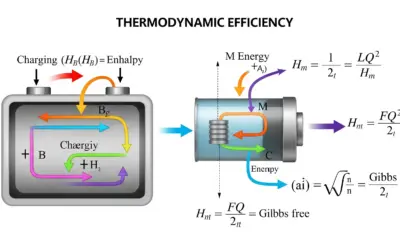
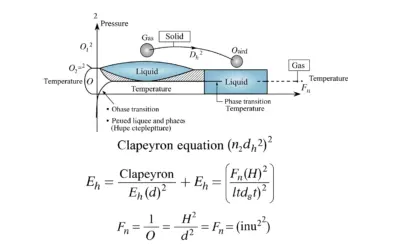
0 commentaires